
par le Divers lacanien
Strasbourg, le 19 septembre 2015
George-Henri Melenotte : Bonjour Guy Le Gaufey ! Merci d’avoir accepté cette interview pour Le Divers lacanien.
Vous venez de publier, pratiquement d’affilée, deux ouvrages aux éditions EPEL, Hiatus sexualis et Une archéologie de la toute-puissance. Ma première question porte sur la traduction que vous avez faite d’une autobiographie, celle de Robin George Collingwood. Ce texte de Collingwood vous offre une méthode heuristique que l’on retrouve dans les deux ouvrages cités.
Dans l’introduction à cette autobiographie, vous faites répondre ceci à l’un des protagonistes qui interroge son compère sur ce qui soutient sa démarche : « La conviction qu’il existe des chaînes formelles relativement indépendantes de l’expression qu’elles peuvent trouver dans telle culture, telle époque, tel auteur. C’est un pari au sens où l’on peut estimer qu’aucune preuve ne viendra asserter l’existence d’une logique profonde en acte dans ces diverses occurrences, si profonde qu’elle en serait transhistorique et transculturelle. Seul son pouvoir heuristique plaide en faveur de cette conviction qui cherche à apparenter ponctuellement des constructions que ne relient aucune filiation directe et qui œuvre dans des champs plutôt hétérogènes, pour ne pas dire plus. »
Pourriez-vous nous en dire plus sur cette démarche ?
Guy Le Gaufey :
D’abord merci de rappeler cette affaire de traduction de Collingwood, parce que cette traduction n’a pas eu un grand succès éditorial. En grande partie due au fait que Collingwood est très peu connu en France d’une part, et que son ouvrage touche à la méthode historienne et que EPEL n’est absolument pas une maison d’édition dans ce créneau-là. Et donc, la parution de cet ouvrage est tombée dans un silence général. Personne ne l’a remarqué. Ni dans le milieu analytique parce que ce n’est pas en rapport avec ça, et même dans le milieu historien puisque quelqu’un qui s’occupe maintenant de la revue Annales m’avait dit qu’il en ferait un compte-rendu et il n’a pas eu le temps non plus. Et aussi bien les ventes que les comptes-rendus ont été à peu près inexistants.
Donc merci de rappeler ça, parce que pour moi, c’était très important cette lecture que je dois en partie à Alain de Libera. J’ai eu grand plaisir à traduire ce texte pour deux raisons. D’abord parce que c’est un anglais parfait, vif, mordant, souvent drôle, très oxfordien. Et puis c’est arrivé à un moment où je ne pouvais rien faire d’autre et ça m’a beaucoup relevé le moral de pouvoir mener ce travail à bien.
Cela dit, depuis que j’avais commencé mon premier livre, à la différence des articles qui traitaient de problèmes particuliers, dès le premier livre j’ai voulu faire autre chose qu’un gros, gros article. Et donc, j’ai été amené sans le chercher, sans même le vouloir, à mélanger des épistémès (pour prendre ce terme foucaldien) très, très différentes et sans désir de les articuler tellement les unes aux autres et de façon très vague et assez irréfléchie. Et j’avais pour m’aider, seulement quelque chose de la méthode de Foucault. Du premier Foucault, de L’Histoire de la folie, de Les mots et les choses, en passant par la Naissance de la clinique et tout ça, jusqu’à L’archéologie du savoir, qui me permettait de ne pas respecter les classifications universitaires bien corsetées qui depuis toujours me cassaient les pieds. Mais c’était sans pour autant pouvoir produire quoi que ce soit de méthode. Je le faisais comme ça avec l’idée, en effet, qui tenait un petit peu à ma formation sémiotique et logicienne, qu’il y avait des structures logiques qui sous-tendaient les discours et, sans que ce soit une logique éternelle ou permanente, il y avait quand même des organisations discursives qui passaient je ne sais pas comment. À un moment donné, j’ai d’ailleurs voulu me servir de la métaphore chimique de l’osmose. Il y avait des trucs qui glissaient d’un savoir à l’autre sans qu’on sache très bien où était la porosité, comment ça passait. Donc tout ça était vague et me laissait assez mal à l’aise. Et à la fin d’une introduction, je ne sais plus laquelle, dans Le lasso spéculaire ou Anatomie de la troisième personne, j’avais repiqué sur Foucault en disant à quel point il me servait pour bousculer l’ordre des savoirs établis. Mais c’était plus une révérence qu’une référence. Autant je peux apprécier ce Foucault-là, autant méthodologiquement je ne pouvais pas vraiment le suivre.
Sa notion d’épistémè est tellement pratique, enfin, elle est autant pratique que floue. Sa notion d’énoncé que j’ai exposée et critiquée par ailleurs, est elle aussi passionnante et insaisissable. Mais il n’y avait que lui qui pouvait s’en servir, en gros. Donc, je ne pouvais pas me prétendre foucaldien quand je mélangeais la crise iconoclastique à Byzance et le stade du miroir ou des choses comme ça. Et je restais en manque d’une définition un peu correcte de la méthode. Et quand j’ai lu cette autobiographie où Collingwood expose lui aussi, quatre ans avant sa mort, ce qu’il en est de sa double casquette de philosophe d’un côté et d’archéologue de l’autre – il a inventé ce qu’il appelle d’une très mauvaise expression, très mal traduite « les complexes questions-réponses »-, j’ai compris que c’est là-dessus que je misais depuis longtemps. Autrement dit, c’est une affaire à juste titre vague. Il s’agit d’imaginer qu’il y ait dans des époques et des épistémès fort différentes, un ensemble de questions et de réponses, un ensemble vague lui-même qui couvre des problématiques qui sous-tendent des discours extrêmement différents mais qui ont une armature architecturale relativement semblable et que ça, ça passe, parce que je suis intéressé depuis toujours par la question de l’inhibition dans le travail intellectuel. Et quand une inhibition est levée, on ne sait jamais où ça va se jouer. Ça ne joue pas au lieu de l’inhibition, c’est ailleurs que tout d’un coup quelque chose est libéré et j’étais persuadé, par l’intérêt que j’avais porté dans les annales des histoires des sciences, que tout d’un coup quelque chose devenait possible parce qu’un point imaginaire avait été travaillé différemment par ailleurs.
Un exemple d’une lecture actuelle. Je vous recommanderai vivement le livre de Vigarello qui s’appelle Le propre et le sale, qui est une histoire de la propreté du Moyen Âge à nos jours. Eh bien, pendant des siècles, jusqu’au XVIIIème, XIXème, on s’est abstenu de se laver parce que l’eau, l’eau tiède surtout, avait très mauvaise réputation. Elle était supposée ouvrir les pores de la peau et les maladies rentraient par les pores. Le résultat : on s’essuyait. Donc on ne se lavait qu’en cas d’extrême nécessité. Et quand il fallait laver, comme pour les nourrissons, après les avoir lavés, on les enduisait de quelque chose pour boucher les pores de manière à ce que la maladie n’entre pas trop vite. Il a fallu beaucoup d’étapes pour que la valeur idéologique de l’eau change et qu’on se mette à se laver pour ouvrir les pores parce que la peau respirait. Il a fallu tout ça. Eh bien, ce genre d’événement très long, très lent, change l’imaginaire tout doucement et c’est ça qui tout d’un coup déclenche quelque chose.
Il y a un autre livre, moins intéressant, qui raconte comment se sont terminés les duels. Les duels étaient interdits royalement dès le XVIIe et tout le monde a continué à se battre en duel pour la moindre des peccadilles. Et au début du XIXe, je ne sais plus quel ministre anglais a été insulté. Il a défié le journaliste en duel et ils se sont battus. Et tout le monde a dit : « Quelle bande d’imbéciles ! », « Qu’est-ce que c’est cette histoire? » Et il n’y a plus eu de duel depuis ça. Non par la législation, mais par le mépris et la rigolade.
Ces changements imaginaires m’importent pour en revenir au savoir et il n’est pas toujours facile de les débusquer. Mais je pense que quand on étudie d’un peu près Lacan, qui a pris le contrepied de beaucoup de points comme ça, souvent de façon inspirée, d’autres fois de façons dues à sa culture, c’est assez important pour moi en tout cas de remonter historiquement à d’autres épistémès, d’autres savoirs pour voir où s’est passé ou a pu se passer, car ce n’est pas si certain, le point de levée de l’inhibition.
Par exemple, dans Le stade du miroir, dès le départ, dès 1936, Lacan considère que l’image dans le miroir n’est pas une représentation. Ça, c’est très fort ! Parce que dès le XVIIe, l’image est prise dans la problématique de la représentation. Je ne sais pas pourquoi lui s’en dégage, mais en tous cas il est clair qu’il s’en dégage. Même si on dit qu’il est dans le fil surréaliste. Je veux bien mais bon, il s’en dégage. Et donc, étudier le stade du miroir, le proposer au lecteur, c’est forcément lui proposer de se dégager de cet imaginaire silencieux : image = représentation. Donc, le détour par la crise iconoclastique n’étant pas dans nos traditions, par chance, je suis tombé sur le « Discours contre les iconoclastes » de Nicéphore, qui est un véritable traité de sémiotique. Et là, j’ai trouvé ce que je cherchais : ça m’instruisait sur le trajet des regards et je faisais double bénéfice. Mais le premier travail était de décrocher image et représentation.
Voilà pourquoi je reviens à Collingwood. C’est que lui me permettait de justifier ce qui avait été ma méthode alors que je ne le savais pas. Donc ça m’a doublement emballé, comme je vous le disais à propos de cet exercice de traduction que j’affectionne. J’en suis venu à faire une grosse différence, au fil des années, entre le British English et le North American English. J’aime beaucoup les Américains mais je préfère l’écriture British… Bon, c’est un sujet délicat!
George-Henri Melenotte :
La méthode dont vous parliez permet quand même de dégager de façon transhistorique des structures formelles, la persistance de structures formelles qui s’expriment sur le mode imaginaire de façon différente et de ce point de vue-là, Lacan n’a plus une production hiératique qui serait coupée du monde et, j’allais dire, d’une tradition mais il s’inscrit dans une histoire de ces structures formelles qui restent relativement intactes même si elles prennent des formes, des formulations différentes. Est-ce que vous iriez dans ce sens ?
Guy Le Gaufey :
I wouldn’t go that far ! Je n’irais pas si loin. Parce que c’est le mot de persistance qui ne va pas. Ce n’est pas que ça persiste, c’est que tout d’un coup, ça se répète, on ne sait pas très bien pourquoi. Mais je suis assez opposé à l’idée d’une persistance, d’une rémanence des questions elles-mêmes. Tout d’un coup, face à des interrogations actuelles, face à des problèmes actuels, il faut réagir, il faut répondre comme disait Collingwood. Tout ce qu’on rencontre, tout ce que le travail historien rencontre, aussi bien dans l’histoire des idées que dans l’histoire des faits et des événements, ça a été des réponses à des questions. Il faut retrouver la question pour apprécier ce qu’il en est de la réponse. Si on se livre à ce travail d’essayer de retrouver la question, alors il faut la reconstruire, elle n’est pratiquement jamais donnée par la réponse. Tout au contraire, les réponses oublient leurs questions. C’est le propre du travail de chacun : faire oublier les questions qui l’ont agité. Quand, lecteur, on retrouve la question, à ce moment là, mon hypothèse est que l’éventail symbolique n’est pas si large que ça. Et que donc, on se retrouve mettre en œuvre, le plus souvent sans le savoir, des réponses qui ont été données à des questions d’il y a souvent quelques siècles parce que, quelles que soient les différences de situation, formellement l’éventail des réponses n’est pas si large, encore une fois. C’est pour ça que ce n’est pas tellement que ça persiste, c’est que la dimension symbolique étant ce qu’elle est, en dépit de ses transformations et bouleversements, tout n’y est pas possible. Et donc, les réponses ont tout d’un coup des airs de famille pour le lecteur qui va venir après, pour peu qu’il ait réussi à remonter jusqu’aux questions qui ont amené lesdites réponses.
Mais pour celui qui met en œuvre sa réponse, bien souvent il le fait à l’aveugle. Des fois, il est instruit et il va copier, souvent. La fameuse question du cogito, est-ce que c’est Descartes qui l’invente ou est-ce que c’est saint Augustin ? Bon, il est certain que Descartes connaissait fort bien son Augustin. Mais en même temps, ce n’est pas chez Augustin qu’il a trouvé le cogito. Donc, il y a un indéniable travail d’invention.
On est face à des problématiques qui – du fait si j’ose dire de la relative pauvreté du symbolique, en dépit de sa puissance et de tout ce qu’on voudra – forcent à des répétitions et si on les met en scène, si on les met en jeu, elles se déplient et s’ouvrent comme des fleurs japonaises. On voit alors beaucoup mieux ce qui a été laissé de côté dans la construction elle-même et qui donc est possiblement à reprendre.
Et j’en veux comme exemple qui vous ira directement au cœur le moment où Freud écarte grosso modo la psychose et la renvoie à Jung et à la psychiatrie. Évidemment, il définit mieux son champ, mais qu’est-ce qu’on y perd ! Et quand on va voir ce qu’on a perdu au passage, on ne peut pas le retrouver sans foutre en l’air la méthode elle-même ! Mais de revisiter ce chantier, c’est comme un courant d’air dans une pièce trop bien fermée.
George-Henri Melenotte :
Dans la belle conclusion de votre livre Hiatus sexualis, vous mettez en garde ceux qui pensent souvent trop vite, que l’inexistence se réduit à un non-être. Vous référant au grec, vous soulignez qu’ils ont ouvert la voie de la possibilité d’un nombre avec lequel il est exclu qu’on entre en relation. Le « il n’y a pas » ne signifie pas que l’on tombe ainsi dans la pire indistinction d’un pur néant. Je me réfère à la décision platonicienne de distinguer entre arithmos et alogon. L’existence d’un non-être, lequel non-être n’est pas pour autant rien, présente la singulière propriété, je vous cite, « de pouvoir rejoindre en une seule opération les élus de plein droit ». Donc, je vous cite toujours, « il existe aussi des non-êtres qui possèdent des qualités concrètes déterminées qui les singularisent.» Eh bien, ce point est un point de départ à partir duquel vous vous référez à Hegel et à la notion de conscience malheureuse qui rejette l’irrationnel comme grand Autre, comme étranger au domaine de l’épistémè. Mais pour autant, cette conscience malheureuse ne peut se débarrasser de cet irrationnel. « Elle est contrainte d’admettre la présence en son sein du savoir positif du non-être, sa consubstantialité avec l’intimité du Soi », écrivez-vous. Eh bien, ce point décisif de votre argumentation appelle un commentaire, et lequel feriez-vous ?
Guy Le Gaufey :
Je n’ai pas beaucoup insisté sur la conscience malheureuse mais j’étais bien obligé de la mentionner. Parce que face à cette existence du non-être, bien évident dans le fonctionnement de la langue, il y a plusieurs attitudes possibles et la conscience malheureuse est celle qui déplore cet état de chose et qui ambitionne, qui pense que dans un monde parfait, il ne devrait pas arriver de telles choses. Qui ne voit pas que cette inexistence-là est la condition de fonctionnement même de ce merveilleux appareil symbolique. Il n’y a aucun malheur à tirer de là. Et Hegel l’entend bien d’ailleurs puisque la conscience malheureuse, pour lui, est une stase dans la Phénoménologie de l’esprit. C’est un arrêt sur image, ce n’est pas du tout la fin d’un processus.
Qu’est-ce que je pourrai dire sur cette inexistence-là ? Ça me fait penser à une chose que j’ai oubliée dans ma réponse précédente. Parce que ma formation d’historien de départ, m’a amené à beaucoup attendre, beaucoup miser sur le fait que la rationalité vient massivement de l’histoire.
C’est au point que Jean-Claude Milner, un jour, me l’a reproché ouvertement et non sans raison. Je ne sais plus, on l’avait invité à une livrauthèque pour un de ses ouvrages sur les noms propres, je ne sais plus, et il m’a dit justement ça, que je misais trop sur la rationalité de l’histoire. Lui, structuraliste, ne méprisant pas l’histoire mais enfin pensant quand même que les fonctionnements structuraux étaient bien plus décisifs et importants qu’une rationalité historique livrée aux aléas de l’histoire, à la contingence et tout ça. Mais j’ai accusé le coup et vingt cinq ans plus tard, je me souviens de sa réflexion en pensant qu’il avait raison parce que j’accordais trop à la rationalité historienne. Et il faut bien dire que je continue. Mais je sens bien ce trop-là et j’essaie de lutter contre, parce que effectivement, ce qui vient avant n’est pas forcément la cause de ce qui vient après. Loin de là. La causalité est bien plus complexe que ne le voudrait un récit historien. Les historiens eux-mêmes, depuis plus de cinquante ans, ayant mis beaucoup de sophistication sur ce point et tombant peu, dès qu’ils sont un peu de qualité, dans ce travers-là.
Mais il y a beaucoup de ça chez les psychanalystes, surtout chez les freudiens orthodoxes qui expliquent tout par le passé. Il y a un fatalisme freudien. Il a sa source là, c’est une causalité strictement historisante. Donc il y a d’autres choses en jeu. Mais cette autre chose est en même temps très ténue. Si je devais plaisanter, je dirais : la rationalité historienne et la causalité historique, c’est de l’ordre du 90 – 95%, mais ce n’est jamais 100%. Comme toujours, les souvenirs infantiles, c’est une chose, la fabrication du fantasme, c’est pas tout à fait la même !
J’ai beaucoup insisté, dans le temps, et encore je vais le faire prochainement, sur le fameux motif secret chez Léonard. Il y a des petits restes diurnes, les Nichtigkeiten, qui sont là, d’accord, c’est très bien. Ça, c’est de la recherche historique et de la rationalité historique, et il faut le faire. Il faut les trouver, comme les restes diurnes. Sans les restes diurnes, bonjour l’interprétation du rêve ! Mais il y a le motif secret. Et lui, ce n’est pas un reste diurne. On ne l’attrapera pas comme ça ! Il y faut au moins le transfert et une attention au signifiant qui, lui, est assez relativement anhistorique.
Par exemple, pour aller vite, dans la phobie, ce n’est pas l’histoire signifiante qui donne les clés de l’élection de l’objet phobique. Ça peut jouer un peu mais ce n’est pas du tout la causalité. Là, elle n’est pas dans le signifiant, à mon avis. En tous les cas, ce n’est jamais une interprétation là-dessus qui lève la moindre phobie. L’émotion, je parle de l’émotion, comme vous me l’avez fait remarquer hier soir. Mais ça m’est revenu cette nuit : il fallait parler de l’émoi. Et la distinction que fait Lacan dans D’un Autre à l’autre ou dans L’Acte, dans un des deux, est tout à fait remarquable. Il faut distinguer l’émoi et l’émotion. Parce que l’émoi est ce qui empêche le mouvement, c’est une suspension complète du mouvement. Et c’est bien de ça que je voulais parler. Je pense que juste après l’émoi vient l’émotion : d’avoir été ému à ce point là.
Pour finir sur cette rationalité historienne, je crois m’être expliqué sur ce qui fait que je ne peux pas ne pas lui donner la priorité mais averti que je suis que ce n’est jamais une totalité. J’essaie de faire intervenir logique et organisation formelle pour montrer qu’il y a un élément de causalité qui n’a pas du tout besoin de s’appuyer sur un avant mais sur un « ça a la même gueule ».
George-Henri Melenotte :
Donc, vous ne tombez pas dans le présentisme à la Hartog. Cette idée de justement tout ramener à un présent qui donne une autre notion de l’histoire que celle qui se rapporte à un passé.
Guy Le Gaufey :
Hartog est un problème à lui tout seul. Parce qu’il a évidemment raison, l’historien est toujours présent, ce n’est pas nouveau. Même quand il ne le voulait pas, il l’était. Donc, on peut montrer sans peine que le présentisme est de toutes les époques. Mais il faut compter avec la démographie galopante des historiens, il y en avait quelques-uns avant, maintenant ils sont partout. Ça compte comme pour les mathématiciens, quand vous en avez dix, c’est une chose, ou les analystes ! Quand il y a douze analystes sur la place de Paris comme en 1950, et quand il y en a 3000 aujourd’hui, les données ne sont franchement pas les mêmes épistémologiquement. Donc, le présentisme a connu des excès, c’est clair, mais il a ouvert une vraie dimension de réflexion dans l’histoire. Quand j’ai étudié l’histoire, il y avait un dicton qui disait : « Tu ne peux faire l’histoire que de ce dont tu peux dire : « Même mon grand-père s’en foutait » ». C’est fini depuis belle lurette. Entre autres parce que les historiens ne peuvent pas faire ça seulement. Mais remarquez bien que chez les historiens, ceux qui sont le plus sur le devant de la scène, ce sont aujourd’hui les médiévistes. D’abord pour une raison bête relative aux archives. Dans l’histoire contemporaine, il y en a beaucoup, beaucoup trop, c’est monstrueux. Dans l’histoire médiévale, on en a trouvé beaucoup plus qu’on ne pensait mais elles sont en nombre respectable et traitables. En plus, les médiévistes ont eu des succès remarquables et donc, maintenant ils tiennent le haut du pavé. C’est certain.
Pour répondre sur cette affaire de présentisme, pour ma part, je ne peux pas suivre cette voie. Je m’intéresse beaucoup aux débats de ce côté-là, j’ai beaucoup lu Hartog mais je n’ai rien pu prendre de ça. Et en plus, je ne tiens pas tellement à présenter une méthode trop peaufinée non plus. J’ai pu en rendre raison, un petit peu, sur les dix livres que j’ai publiés. Ils ont tous suivi la même méthode, il était temps que je la précise. Mais une fois fait cela, je ne la propose à personne comme méthode à suivre. J’ai suivi celle-là pour exposer un certain nombre de choses mais ce n’est pas la méthode pour écrire des livres.
George-Henri Melenotte :
Une dernière question qui portera sur la rupture de l’élastique. Dans Hiatus sexualis, vous jouiez au jokari. Lors de ces jeux, il est arrivé qu’en tapant très fort la balle, l’élastique n’ait pas tenu et que la balle se soit envolée, n’ait plus été retenue à la base. Derrière cette anecdote, vous avancez l’idée que cette expérience vous a permis de repérer l’objet a comme écart. Vous soulignez alors la notion d’objet-rupture. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce moment particulier où, à partir d’une expérience qui vous est propre, vous avez introduit cette notion d’objet-rupture qui est une remise en cause de l’acception traditionnelle donnée au terme d’objet ?
Guy Le Gaufey :
D’une part, il m’importait de commenter l’objet a en tant que perte. Rupture, ce n’était pas tout à fait ça, mais perte, oui. Et c’est alors que m’est revenu à l’esprit ce souvenir, car c’est un souvenir, je vois encore très bien la rue où je jouais au jokari. Il s’est passé du temps jusqu’à ce que je retrouve ce souvenir au coin de je ne sais plus quel rêve, ceci durant mon analyse, et que je retrouve surtout l’émotion, là aussi, que ça mettait en jeu. Je me souviens bien que cette rupture de l’élastique est arrivée par accident jusqu’au moment où je voulais que ça se répète quand même (un peu ce que je dis de ma méthode pour écrire des livres, by the way !). Et en effet, je tapais comme une brute parce que c’est la règle de ce jeu-là, mais très vite, ça a été plus que ça. Bien sûr, quand ça cassait, je rafistolais illico mon élastique, je refaisais un nœud. Et je savais bien que ça allait se rejouer à l’entre-deux nœuds. Il y avait tout un truc qui m’est apparu dans l’analyse où je voyais bien qu’il y avait un tripotage à cet endroit-là, un tripotage qui n’était pas catholique, si j’ose dire. Et ça m’a beaucoup amusé parce que, à ce moment-là, durant cette analyse – on est en 74-75, je ne sais plus, et je suis en plein dans les textes de Lacan, et les séminaires, et tout – je me dis un jour : « Eh bien voilà, voilà mon affaire ! » parce que je voyais bien que ça avait à faire avec ce que j’appelais le royaume maternel.
Ma mère, bien sûr, s’en foutait éperdument. Là n’est pas le problème. Mais quand cette balle fichait le camp, il se trouve que c’était dans une rue où il n’y avait, à l’époque, pas beaucoup de passage. Si la balle partait, elle allait vers le carrefour. Et là, le carrefour, lui, il était placé sous l’interdit maternel. Je pouvais aller dans la rue, mais en aucun cas au carrefour. Je n’avais, au demeurant, pas une envie folle d’aller vers ce carrefour. Mais si ma balle y allait, il fallait bien que j’y aille ! Donc il y avait là, disais-je, un tripotage. Je voyais bien, d’un côté, que je n’étais pas l’esclave de ma mère qui était une brave femme, mais enfin, d’un autre côté, si j’ai eu pas mal de phobies, je les lui dois aussi. Cela dit, cette balle était un peu trop belle, comme tous les exemples d’objets a, qui sont forcément boiteux. L’important, de toutes façons, ce n’était pas tellement la balle que je finissais par récupérer, c’était la rupture de l’élastique. C’était l’endroit où ça cassait, quoi. Le véritable objet était là.
Et c’est alors que je suis tombé sur le séminaire de 59, Le désir et son interprétation. C’est la première fois que Lacan dit que l’objet est une rupture. L’objet-coupure, il appelle ça l’objet-coupure. Je suis persuadé que l’auditeur de cette époque ne pouvait rien entraver de ça, ne pouvait rien comprendre. Et lui-même n’est pas clair du tout. Il faut qu’arrive non seulement Le transfert, mais surtout L’identification, pour réussir à donner un vrai statut de coupure à l’objet via la topologie. Et à partir de là, ça n’est plus aussi absurde de considérer que l’objet, ce n’est pas l’objet, c’est la coupure. Et ça, évidemment, ça a tout de suite donné du relief à mon élastique.
George-Henri Melenotte.
Merci beaucoup, Guy Le Gaufey.
Interview réalisée par Dominique-Anne Offner et George-Henri Melenotte
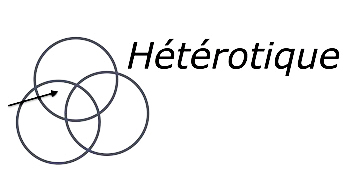
Write a comment