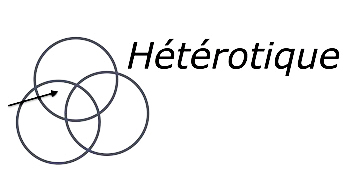Séminaire : Du trait à l’écrit
Séminaire : Du trait à l’écrit
George-Henri Melenotte
Séance du 20 février 2019
–
Tenter de penser l’impossible
Et ne pas y parvenir.
Ludwig Wittgenstein
Je voudrais commencer aujourd’hui par la dernière phrase de la séance précédente du séminaire. Lacan y dit ceci à propos de l’analyste qui « tranche à lire » :
Il y a beaucoup de jeu, au sens de liberté, dans tout cela. Ça joue, au sens que le mot a d’ordinaire.
Les mots que je retiens de ce passage tiré de la séance du 20 décembre 1977, du séminaire Le moment de conclure, sont « liberté » et « jeu ».
Dans l’écriture calligraphiée, à tout moment du tracé de ce qui va devenir une lettre, j’ai la possibilité de changer d’avis et de produire un graphisme qui sera tout autre que celui qui fonctionne comme forme de la lettre. Nous avions jeté notre dévolu sur la lettre e qui avait l’avantage de nous permettre de repérer facilement le point de lisibilité en-deçà duquel il était impossible de reconnaître l’image de la lettre. Tant que, dans le geste du tracé, je suis en amont de ce point, j’ai toute liberté de le modifier et de produire autre chose : un poisson, un œil ou autre chose encore, comme un simple gribouillis. Et même après le franchissement de ce point, j’ai toute latitude pour riper en b au-delà du tracé convenu de la lettre, ce qui produira comme effet un dérapage de ligne. Une telle sortie de la figure imposée de la lettre relève de la liberté. La possibilité est offerte à la main de sortir des règles de l’orthographe, soit des règles de la façon droite d’écrire, pour donner de l’air à son geste et le faire baguenauder selon son caprice et ainsi produire un graphisme non reconnaissable.
Avec cette liberté du trait, il y a la possibilité offerte à toute écriture, quand elle est manuelle, de s’évader comme un prisonnier de sa prison, de se libérer de la tutelle de la règle pour se balader dans le double sens de ce mot, avec un l ou avec deux l dans la production du graphème. Dans le cas de se balader avec un l, je me balade signifie que je me promène, comme cela peut être le cas au bord d’une rivière, je flâne, je marche au bord de l’eau sans autre objet que de cheminer sans but en profitant du hasard de la balade. Elle peut m’amener à découvrir un papillon qui se pose sur une fleur. Comme Rousseau, je pourrai me mettre à herboriser alors que rien dans mon intention ne me prédisposait à une telle activité. Je vais au gré de ma balade et je découvre ce qu’autrement je n’aurais jamais vu. Souvenons-nous de ce poème de Baudelaire, publié en 1861 dans la deuxième édition des Fleurs du mal, que je m’en vais vous lire :
À une passante
La rue assourdissante autour de moi hurlait.
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,
Une femme passa, d’une main fastueuse
n, Soury, Soulevant, balançant le feston et l’ourlet ;
Agile et noble, avec sa jambe de statue.
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,
Dans son œil, ciel livide où germe l’ouragan,
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.
Un éclair… puis la nuit ! – Fugitive beauté
Dont le regard m’a fait soudainement renaître,
Ne te verrai-je plus que dans l’éternité ?
Ailleurs, bien loin d’ici ! trop tard ! jamais peut-être !
Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,
Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais !
Voilà, il se balade, et soudain, une femme passe, à la main fastueuse et à la jambe de statue. L’aurait-il vue sans la disponibilité de sa flânerie alors qu’elle ne fait jamais que passer là. Le temps d’une seconde, il voit son œil, non pas l’organe froid, mais ce « ciel livide où germe l’ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue ». Cet œil devient regard qui « soudainement » le fait renaître. Tout ceci ne dure que le temps d’un éclair. À peine l’a-t-il vue qu’elle n’est déjà plus là, perdue dans la foule, et lui déjà si loin. Un amour fulgurant aurait pu suivre le temps du regard. Le poète s’en est trouvé ouvert sur l’éternité.
Il y a la ballade avec deux l qui est un poème ou une chanson douce. Ce peut être aussi une pièce musicale au piano. Le sens du terme oriente vers la poésie. Dans les deux cas, la poésie rôde aux alentours de cette liberté ou de ce jeu dont parle Lacan.
La poésie de Michaux est une poésie de l’écriture. Il l’utilise comme poésie de la main qui, par son geste, se libère de son incarcération dans la typographie, dans le caractère déjà tracé de l’imprimeur ou des touches de l’ordinateur. La poésie dans l’écriture se glisse dans le dessin de la lettre qui, à tout moment, confine à l’illisible, vire au dessin à moins que ce ne soit à des caractères non identifiables. Le trait libre de son tracé fraie dans un ailleurs. Telle est l’ouverture que Michaux produit vers un espace poétique. Vous voyez en quoi consiste cette expérience poétique. Michaux use de la liberté dans le tracé de son écriture et ouvre des espaces inconnus.
Je vais vous montrer quelques-unes de ces figures que l’on qualifie bien imprudemment de dessins parce qu’il n’existe pas de mots dans la langue susceptibles de les identifier. Ces graphismes chez Michaux ne sont pas dissociables de l’expérience poétique. Quand on voit ceux produits sous mescaline, on perçoit le délitement de l’écriture qui dérape jusqu’au trait, mettant en évidence la liberté du geste quand il sort de la lettre pour retourner au trait. Et que faire aussi de ces pages faites de caractères d’aucune écriture, dont on suppose que c’en est une sans que l’on puisse la reconnaître ? À moins que ce ne soient des personnages qui défilent en ordre ou des graphèmes en marche. L’écriture de Michaux produit une indétermination dans la lisibilité. Elle évolue à la frontière du lisible et en sort quelquefois pour entrer dans un espace non codifié du trait où la main déploie un geste ludique et libre.
Voici quelques graphismes michaldiens :
Figure 1 :
Sont-ce des tâches ? Ou bien les pictogrammes d’une écriture inconnue ? Ou bien des dessins mal fagotés ? Et s’il s’agit d’une écriture ? Comment sont disposés les blancs entre chaque caractère ? Forment-ils un mot ? Une phrase ? Quel sens cela peut-il bien avoir ? Est-ce que c’est beau ? Quelle serait l’esthétique qui officie alors ? Ou bien s’agit-il des figures d’un graphisme qui ne signifie rien ? Ce serait une façon d’écrire le rien.
Figure 2 :
J’ai donné un nom à ces graphèmes. Je les ai appelés « graphèmes dansants ». C’est sans doute par excès d’anthropomorphisme. Mais comment être insensible au mouvement et à la légèreté de ces figures qui témoignent d’un jeu ? Serait-ce des lettres où l’on verrait qu’elles ont un corps et que, comme tout corps, il leur arrive de se mettre à danser.
Figure 3 :
Nous voilà conviés à l’expérience des écrits mescaliniens de Michaux. Il écrit sous mescaline. Sur la page de gauche, on assiste au dérapage de sa plume. Il perd littéralement la main. Les mots ne s’alignent plus, la phrase se balade sur la feuille blanche. Elle penche sur la gauche puis sur la droite. Elle tombe. Il se reprend et perd de nouveau la main. L’écriture devient vibratoire, quasi sismographique comme si elle enregistrait un tremblement. Et l’on passe à l’illisibilité du trait qui se juxtapose aux autres. Puis ce trait se fait ligne ondulante qui va en tout sens. Sur la page de droite, le trait devient griffure. La main use de ses ongles, la lacèrent plus qu’elle n’écrit. Sa liberté la fait patte d’un fauve qui frappe le papier. Michaux dira de ses écrits sous mescaline qu’ils étaient souvent inutilisables du fait de ce glissement incessant vers l’illisible. Passé l’effet de la substance, il lui faudra réécrire le tout pour lui donner lisibilité. Le geste poétique réside dans ce premier jet de la main. C’est là une expérience de l’écriture qui inclut l’illisible du trait. Il n’est plus seulement graphisme mais griffe de la bête.
Figure 4 :
De cette figure, j’ai retenu ce qui se donne comme remarquable à voir quand se produit le moment de bascule où le trait prend le dessus sur le lisible, quand le lisible ne figure plus sur la feuille blanche que sous la forme d’îlots. Ce qui importe alors est la persistance du trait qui crée l’espace nouveau jusque-là réservé à l’écriture lisible, espace de la liberté poétique du trait quand il ne se soumet plus à aucune forme imposée. Le prix de l’opération est que le sens s’envole, se volatilise. Il ne reste plus qu’un espace nouveau produit de l’effacement progressif de la lettre au profit du trait, d’un graphisme qui ne signifie plus rien.
J’espère avoir l’occasion d’y revenir mais je dois à mon ami Rafael Omar Perez l’attention sur d’autres expériences dans la littérature proches de celle de Michaux. Ainsi celle d’Imre Kertész. Je vous recommande la lecture du livre de Clara Royer, intitulé « Imre Kertész : l’histoire de mes morts » où elle montre combien Kertész engagea un combat pour l’écriture. C’est une écriture d’une autre nature que celle de Michaux, une écriture prise comme acte existentiel, comme acte de transformation subjective qui lui a permis de liquider son passé, celui des camps de concentration qu’il a connus à l’âge de quatorze ans, et de créer une œuvre. Tout dans l’écriture de Kertész est trempé dans l’expérience des camps de la mort. Il n’y a pas une ligne chez lui qui ne puise dans cette expérience. Elle lui permet de se transformer en liquidant la mémoire incluse dans son écriture, d’accéder à une nouvelle subjectivité débarrassée de l’empreinte de l’extermination. Si l’un ou l’autre d’entre vous s’y intéresse, qu’il ou elle me fasse signe et nous prendrons du temps pour nous arrêter sur son incroyable expérience de l’écriture qui devait le mener au prix Nobel.
Puisqu’il a été question de la lecture, du lisible et de ce qui ne l’est pas, nous pouvons revenir à Lacan, dans la séance du 10 janvier 1978, du séminaire Le moment de conclure. Mais avant de lire certains passages de cette séance, il importe de souligner que, dans ce séminaire, il y a un usage réglé de l’écrit et de l’écriture.
Dans cette séance du 10 janvier, Lacan parle de l’écrit, celui que l’on couche sur le papier et que l’on ne lit jamais. Il en profite pour dire que si la passe pourrait se faire par écrit, l’inconvénient serait qu’on ne le lirait pas :
L’ennuyeux c’est que, ces écrits on ne les lira pas. Au nom de quoi ? Au nom de ceci que de l’écrit on en a trop lu. Alors quelle chance y a-t-il qu’on le lise ? C’est là couché sur le papier, mais le papier, c’est aussi le papier hygiénique. Les chinois se sont aperçus de ça, qu’il y a du papier dit hygiénique, le papier avec lequel on se torche le cul. Impossible donc de savoir qui lit.
Voilà dit sans ménagement le devenir de ce que l’on couche sur le papier. En plus de l’usage hygiénique du papier, il est impossible de savoir qui lit. Soit cette chose qui fait que l’écrit ne nous informe pas sur aa lecture. Mieux même, un écrit peut dormir là, des années, sans être lu. Il sommeille. Dès lors, se pose la question de savoir si un écrit non lu peut toujours être considéré comme un écrit. Car un écrit l’est-il vraiment tant qu’il n’est pas encore lu ? On distinguera l’écrit lu de l’écrit non lu.
Lacan nous invite à une nouvelle distinction entre le lu et le lisible. L’écrit suppose toujours sa lisibilité, alors que ce n’est pas le cas de l’écriture puisque comme le montre l’écriture michaldienne, elle peut produire de l’illisible.
On pourra écrire ces formules :
L’écrit porte sur le lu.
L’écriture porte sur la lisibilité.
Revenons à Lacan dans cette séance. Je vous lis ce passage :
Il y a sûrement de l’écriture dans l’inconscient, ne serait-ce que parce que le rêve, principe de l’inconscient, ça, c’est ce que dit Freud, le lapsus et même le trait d’esprit se définissent par le lisible : un rêve, on le fait, on ne sait pas pourquoi et puis après coup, ça se lit, un lapsus de même, et tout ce que dit Freud du trait d’esprit est bien comme étant lié à cette économie qu’est l’écriture, économie par rapport à la parole.
Vous percevez le mouvement logique que Lacan effectue. Il part de l’affirmation qu’il y a « sûrement » de l’écriture dans l’inconscient. Il la justifie par le fait que le rêve, le lapsus et le mot d’esprit sont « lisibles ». Et que c’est même ce lisible qui les définit.
Qu’est-ce à dire ? Dire qu’une chose est lisible n’est pas dire qu’une chose est lue. Tout comme nous distinguions l’écrit de l’écriture, il convient maintenant d’introduire dans le lisible deux catégories. Il y a le lisible qui peut être directement lu. Et il y a le lisible qui suppose une opération avant de pouvoir être lu.
Dans le premier cas, le lisible peut facilement être lu. Clarté, limpidité, facilité de compréhension sont alors les caractéristiques de la lisibilité d’un texte. Est lisible un texte facilement lu. Sa lisibilité est directe.
Dans le second cas, un texte accède à la lisibilité lorsque, quand bien même il serait obscur, on dispose d’une méthode qui le rende à la clarté. Tel est le travail de Deutung du rêve, terme allemand traduit pour interprétation et que Lacan traduira par « déchiffrage ». Tout rêve est lisible bien que son énoncé soit obscur. C’est là une décision devant cette obscurité : elle pose que celle-ci n’est qu’apparente et que, à condition d’être muni d’un bon outil, il peut être rendu à sa lecture par son déchiffrage. Pour cela, il faut une méthode qui donne lisibilité au texte manifeste du rêve. Sa lisibilité est indirecte. Elle réside dans le déchiffrage de son contenu manifeste.
Le 2 novembre 1973, lors du Congrès de la Grande Motte, Lacan intervient de façon explicite sur ce point :
Les formations de l’inconscient, comme je les appelle – comme je les ai appelées il y a bien longtemps – démontrent leur structure d’être déchiffrables. C’est de là que Freud distingue la spécificité du groupe rêve, lapsus et mot d’esprit, soit du mode, le même, dont il opère avec eux : il les déchiffre.
Nous sommes cinq ans avant le séminaire « Le Moment de conclure ». Si nous remplaçons « déchiffrables » par « lisibles », alors les formations de l’inconscient : lapsus, rêves, mots d’esprit, actes manqués, oublis sont déclarées comme lisibles. C’est là le geste majeur qui rend possible l’analyse. Elles le sont du fait de leur structure. Elles ont une structure langagière donc accessible au déchiffrage. Un texte manifeste n’a donc rien d’aléatoire. Freud pose l’affirmation de la lisibilité indirecte du texte manifeste comme un axiome et il fournit la méthode qui fait passer ces formations de la lisibilité indirecte à la lisibilité directe donc à la lecture. Par le déchiffrage, on passe du supposé lisible à du directement lisible. Lacan, lors de la même intervention, se réfère au travail du rêve dans la Traumdeutung :
Le travail est reconnu à l’inconscient du chiffrage. L’inconscient tout seul fait ce travail du chiffrage, et c’est pourquoi Freud le désigne de ceci, c’est qu’il ne pense ni ne calcule ni ne juge non plus ; il fait simplement le travail. C’est à la conclusion du chapitre sur le travail du rêve. Il fait ce travail qu’il nous faut défaire dans le déchiffrage.
L’inconscient travaille, il travaille tout seul. Il chiffre le texte pour contourner la censure. Ce chiffrage rend le texte obscur même s’il reste lisible, c’est-à-dire en puissance d’être lu. Il est offert à la lecture à condition d’être déchiffré. Il faudra aller à rebours de son chiffrage pour le déchiffrer, c’est-à-dire le rendre directement lisible et en faire, au bout du compte, un texte lu. Une fois lu, le texte déchiffré devient message. Il livre un savoir. Il est un savoir. La condition de l’émergence du savoir contenu dans le rêve est par conséquent la transformation de sa lisibilité indirecte en lisibilité directe. C’est parce qu’il est posé a priori comme lisible qu’il sera déchiffré et il donnera alors le message de son déchiffrement qui en fera un savoir. Lacan :
Le lisible, c’est en cela que consiste le savoir. Et en somme, c’est court. Ce que je dis du transfert est que je l’ai timidement avancé comme étant le sujet… un sujet est toujours supposé, il n’y a pas de sujet bien entendu, il n’y a que le supposé …le supposé-savoir. Qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Le supposé-savoir-lire-autrement.
Devant le texte manifeste d’un rêve, je suppose qu’il détient un savoir qui m’échappe. Au bout de son déchiffrage, il sera possible de lire ce texte autrement que celui qui est donné initialement et de faire apparaître son message latent qui le constituera alors comme savoir. Pour entreprendre l’opération du déchiffrage du texte manifeste, on lui supposera d’emblée une lecture différente de celle qu’il présente. À l’analyste de supposer un savoir-lire-autrement ce texte. Ce supposé-savoir-lire-autrement définit la position de l’analyste. Le transfert qui, traditionnellement, s’appuyait sur le sujet-supposé-savoir se voit redéfinit par une nouvelle définition qui complète la précédente en donnant à la manière de lire, à la supposition d’un savoir-lire-autrement une importance décisive. Cette supposition permet le déchiffrage du rêve. Elle en est le moteur. Partant de là, il est possible de soutenir qu’un rêve, ça se lit, tout comme un lapsus ou un mot d’esprit.
Reste maintenant ouverte la question de l’écriture. Dès lors que le lisible passe à la lecture et qu’ainsi le rêve se lit, nous voilà renvoyés à sa lisibilité et au déchiffrage qui en permet la lecture. Voilà la thèse nouvelle soutenue par Lacan dans ce séminaire : le déchiffrage n’est rien d’autre que l’écriture dans sa portée dynamique, c’est-à-dire celle qui fait équivoquer l’orthographe.
C’est en ce sens que Lacan affirme que :
1/ Il y a « sûrement » de l’écriture dans l’inconscient.
2/Les formations de l’inconscient se définissent par le lisible.
3/ Tout ce que dit FREUD du trait d’esprit – je rajoute : mais pas seulement –, est lié à cette économie qu’est l’écriture, économie par rapport à la parole.
Un mot d’abord sur ce « sûrement » du point 1. Il ne peut pas l’affirmer puisque l’écriture, comme travail du rêve, n’est que supposée. C’est cette supposition qui permet de soutenir que le passage du lisible au lu passe par l’écriture. Il n’y a pas de chiffrage ou de déchiffrage possible du rêve ou du mot d’esprit sans passer par l’écriture. Nous passons ainsi des processus primaires de la condensation et du déplacement dans le travail du rêve avec Freud, à la métaphore et la métonymie du premier Lacan, pour en arriver à ce « faire équivoquer l’écriture », sous la forme des diverses écritures possibles d’une parole, du Lacan de 1978.
Je voudrais revenir sur l’usage que Lacan fait de l’écriture pour équivoquer. Car la dynamique de l’écriture n’est rien d’autre que cette façon qu’elle a d’équivoquer. J’ai introduit lors de la dernière séance les écritures possibles à partir de « l’être humain » : « les trumains » ou « les trous mains ». Il donne d’autres exemples : le 15 novembre 1977, pour « fait la chose », « fêle achose », le 20 décembre 1977, pour « la géométrie », « l’âge et haut-maître hie », le 11 avril, pour « la sexualité », « l’a-sexe (ualité)», pour « comment faire », « comme enfer », ou pour « le fait d’être religieux », « le faix, f.a.i.x d’être religieux » (le lourd fardeau).
En revenant à la séance du 10 janvier 1978, Lacan revient sur l’équivoque. Voici ce qu’il dit :
Mais justement dans l’analyse, c’est l’équivoque qui domine. Je veux dire que c’est à partir du moment où il y a une confusion entre ce Réel – que nous sommes bien amenés à appeler Chose – il y a une équivoque entre ce Réel et le langage, puisque le langage, bien sûr, est imparfait, c’est bien là ce qui se démontre de tout ce qui s’est dit de plus sûr.
Nous nous retrouvons là devant une problématique bien lacanienne du rapport du mot et de la chose. Souvenons-nous de cette phrase de la séance du 15 novembre 1977, phrase à laquelle nous venons de faire allusion :
Et le mot a une propriété tout à fait curieuse, c’est qu’il fait la chose.
Et il poursuit ainsi :
J’aimerais équivoquer et écrire c’est qu’il « fêle achose », ce n’est pas une mauvaise façon d’équivoquer. User de l’écriture pour équivoquer, ça peut servir parce que nous avons besoin de l’équivoque précisément pour l’analyse.
Tout ceci pourrait paraître comme étant un simple jeu de mots. Toutefois, se trouve dans cette équivoque qui porte sur une simple façon de faire équivoquer l’orthographe, énoncée une position déterminante sur ce qui rend possible l’analyse.
Voici le point : dire que le mot fait la chose signifie que le mot est premier sur la chose. Ce ne sont pas les choses qui font les mots mais, à l’inverse, ce sont les mots qui font les choses. Dès le 26/9/1953, dans Fonction et champ de la parole et du langage, Lacan dit ceci :
C’est le monde des mots qui crée le monde des choses.
Donc, rien de nouveau en1978 par rapport à ce qu’il a dit en 1953. À part ceci : l’équivoque de l’écriture lui permet de dire que si le mot fait la chose, il la fêle en achose. Il casse la chose en y introduisant une fêlure qui détruit la chose en la fêlant. Le fait que la chose soir ratée tient à cette propriété du mot : il fait la chose, et de ce fait, il la rate. Il nomme la chose, il est nommant, c’est le fameux naming de la chose, et par cette nomination même, il la rate parce qu’il la détruit.
À quoi tient ce ratage qu’est une telle fêlure ? Réponse : à ce que le mot est imparfait. Le mot est un mauvais outil. Il y a un réel en jeu dans l’écriture qui tient à ce qu’il n’y a pas d’adequatio intellectus rei, pas d‘adéquation entre le mot et la chose. C’est pourquoi le mot, dans sa tentative d’adéquation au réel, rate ce réel posé comme réel de la chose. Le mot ne nous permet pas de nous faire la moindre idée de la chose en raison de la fêlure qui fait qu’en nommant la chose, il la rate. Le réel lui file entre les doigts comme le sable : il reste insaisissable et coule entre les doigts.
Dans sa tentative de superposition au réel, de mise en adéquation du mot et de la chose, l’écriture rate le réel. Cela tient à ce que toute écriture, dans son fond, tente d’écrire le rapport sexuel et échoue à le faire. Le réel de l’écriture réside dans son échec à écrire un tel rapport. Il y a dans l’écriture une impossibilité à saisir le réel du non rapport sexuel. C’est là le réel de l’écriture. Le réel de l’écriture est l’impossibilité d’écrire le réel du non rapport sexuel qui ainsi lui échappe. Quand Lacan fait équivoquer l’orthographe pour écrire à la place de « le mot fait la chose » « le mot fêle achose », je propose d’écrire « achose » en un mot, avec le a privatif, qui montre combien la chose échappe au mot du simple fait de prétendre la nommer.
Une conclusion dès lors s’impose. Le langage est imparfait. C’est un mauvais outil. Je vous lis la suite :
Le langage est imparfait, y a un nommé Paul Henry qui a publié ça chez Klincksieck, il appelle ça : Le langage : un mauvais outil. On peut pas dire mieux. Le langage est un mauvais outil, et c’est bien pour ça que nous n’avons aucune idée du Réel.
J’ai passé commande du livre de Paul Henry dont je vous parlerai quand je l’aurai lu. Je vous invite à le lire de votre côté si vous arrivez à vous le procurer.
L’écriture de l’inconscient porte en elle-même ce réel de l’impossibilité de saisir le réel du non-rapport sexuel. Il demeure insaisissable du fait de l’imperfection du langage qui est un mauvais outil.
L’écriture de l’inconscient qui est à l’œuvre dans le rêve, le lapsus, le mot d’esprit, l’acte manqué ne nous renvoie jamais qu’à la diversité des façons d’écrire une parole. Mais l’écrit, c’est-à-dire le produit de ces différentes façons d’écrire, rate le réel et ce ratage est bien ce qu’il y a de réel dans l’écriture. L’écrit ne clarifie rien. Il est un résultat piteux du fait de son ratage. Pire, elle n’introduit que confusion dans ses façons d’écrire qui, toutes, témoignent de la fêlure de l’achose. Lacan :
L’inconscient – c’est ce que j’ai dit – ça n’empêche pas de compter, de compter de deux façons qui ne sont – elles – que des façons d’écrire. Ce qu’y a de plus Réel, c’est l’écrit, et l’écrit est confusionnel. Voilà, je m’en tiendrai là pour aujourd’hui, puisque comme vous le voyez, j’ai des raisons d’être fatigué.
–
Revenons au jeu et à la liberté dont nous avons précédemment parlé. Ceci va nous mener à une élaboration inédite par Lacan du rapport de la matière à la pensée.
Comme lorsque l’on ne serre pas assez un boulon et que l’on dit qu’il y a du jeu, la liberté tient au jeu qui subsiste dans toute écriture dès lors que, dans la confection du graphisme, à tout instant existe la possibilité de sortir de la forme imposée pour faire quelque chose d’autre : un dessin, un gribouillage, ou autre chose encore. Lacan :
Tout ça ne me dit pas à moi-même comment j’ai glissé dans le nœud borroméen pour m’en trouver, pour m’en trouver à l’occasion serré à la gorge. Il faut dire que le nœud borroméen, c’est ce qui, dans la pensée, fait matière. La matière, c’est ce qu’on casse… là aussi au sens que ce mot a d’ordinaire…ce qu’on casse, c’est ce qui tient ensemble et est souple, à l’occasion, comme ce qu’on appelle un nœud.
Lacan a glissé dans le nœud borroméen qui l’a pris à la gorge, serré à la gorge à l’occasion, qui l’a étouffé. Allouch dans l’Autresexe étudie la scène de son union sexuelle avec une hystérique où il n’a récolté rien d’autre qu’un rapport avec …le nœud. Si le nœud serre à l’occasion Lacan à la gorge, c’est qu’il est concret. Mais pas seulement.
Le nœud est ce qui dans la pensée fait matière. Si le nœud est une figure topologique, c’est-à-dire de la pensée mathématique, Lacan le prend aussi comme matière. La matière, c’est ce qu’on casse, comme un pot ou un verre. Si l’on casse une consistance du nœud, il se défait, il ne tient plus ensemble, il part en morceaux comme l’assiette lorsqu’elle se brise. La matière peut aussi être souple. Comme le nœud, elle peut se tordre s’étirer, se manipuler. Le nœud, c’est la matière dans la pensée.
Comment ai-je glissé du nœud borroméen à l’imaginer composé de tores, et de là à la pensée de retourner chacun de ces tores, c’est ce qui m’a conduit à des choses qui font métaphore, métaphore au naturel, c’est-à-dire que ça colle avec la linguistique, pour autant qu’il y en ait une. Mais la métaphore a à être pensée métaphoriquement.
Lacan n’en reste pas au nœud. Il fait plusieurs opérations mentales :
1/ Il glisse du nœud au tore. Il « imagine » les consistances comme composées de tores (figure 1).
Ce geste n’est pas si anodin. Puisqu’il passe de l’inconsistance de la droite à celle imaginaire du tore. Il passera aussi du tore à la corde, prise plus trivialement comme consistance que l’on tient au bout des doigts, que l’on manipule par conséquent.
2/ Puis il passe à la « pensée » du retournement de chacun de ces tores.
3/ Le résultat de ces opérations d’imagination et de pensée sont « des choses qui font métaphore au naturel » : la trique, le tissu, la paroi, les trous. Je reviendrai sur ce point qui suppose que nous nous livrions à quelques manipulations.
Si ces choses font métaphore au naturel, c’est la dimension métaphorique des opérations qui importe. Quand Lacan dit que la métaphore a à être pensée métaphoriquement, prenons l’exemple de la trique. La trique, comme le dit l’expression « avoir la trique », c’est bander, donc désirer. La métaphore du corps qu’est la référence au double tore, l‘un contenu dans l’autre, soit une référence à la double enveloppe embryologique, ectoderme et endoderme, qui nous constitue, cette métaphore se transforme par double trouage et retournement des deux tores en double trique, l’une contenue dans l’autre. Métaphore d’un phallus dédoublé dans l’autre, désir incarné dans la chair de l’organe et dédoublé de celui de l’autre. La prochaine fois, je vous montrerai la manipulation.
Alors que ces tores se donnent comme des figures topologiques neutres sexuellement, les voilà fortement sexualisées du fait du langage qui les nomme.
L’étoffe de la métaphore, c’est ce qui dans la pensée fait matière, ou comme dit Descartes : étendue, autrement dit corps. La béance est ici comblée comme elle l’était depuis toujours. Le corps ici représenté est fantasme du corps. Le fantasme du corps, c’est l’étendue imaginée par Descartes. Il y a distance entre l’étendue de Descartes, et le fantasme. Ici intervient l’analyste qui colore le fantasme de sexualité.
Si Descartes distingue la pensée de l’étendue, Lacan se démarque de lui (« la béance est comblée ») pour soutenir que la pensée est étendue, que l’esprit est matière. Il parle de « ce qui dans la pensée fait matière » ou de « ce qui dans la pensée fait étendue, autrement dit corps ». Voilà explicitée la métaphore au naturel. La métaphore comme trope, opération linguistique, tisse une étoffe. Si je dis « or du soir » pour « soleil couchant », je tisse une analogie qui me fait passer de l’une à l’autre expression. Cela fait étoffe dans la mesure où l’opération de la métaphore ici donnée est pure pensée (je pense le soleil couchant comme or du soir) et comme matière (soleil et or étant bien deux choses matérielles).
Quand j’emploie le tore pour une manœuvre de trouage de sa surface et retournement en arriver à la trique, je file la métaphore qui fait de la figure du tore retourné une métaphore sexuelle. Comme métaphore, elle appartient au registre de la pensée. Elle n’en demeure pas moins au naturel puisque, comme trique, elle est une érection. La topologie du tore conjoint pensée et naturel, pensée et matière. Avec la topologie, la pensée se fait matière. Le recours de Lacan à la topologie lui permet de matérialiser la pensée, de s’exercer à la motière qu’est l’écriture. Ainsi quand il dialogue avec le mathématicien Soury dans son séminaire, il tient le nœud par les deux bouts, celui matériel du nœud qui l’étrangle, et celui de la pensée mathématique que lui apporte Soury.
Quand Lacan tient un nœud borroméen en main, il touche les cordes des consistances comme autant d’objets matériels, et pourtant, dans le même mouvement, il tient au bout des doigts la pensée mathématique du nœud avec ses spécificités comme celle dont rend compte le triskel.
Quand il parle ici de fantasme, c’est le fantasme tel que pensée et matière ne font plus qu’un. Ceci suppose que vole en éclats la dichotomie cartésienne qui sépare la pensée de l’étendue au profit d’une pure et simple continuité entre les deux. D’où la formule « le corps est fantasme du corps ». Matérialité du corps et esprit du corps dans le fantasme ne font jamais qu’un. Tout irait bien dans cette voie s’il n’y avait la couleur que l’analyste introduit dans un tel fantasme : couleur de sexualité qui introduit un trou dans cette pensée matérielle du corps.
Ainsi parler de l’écriture revient à parler de l’étendue de Descartes. L’équivoque de l’écriture se manifeste concrètement dans le geste d’écrire sur papier, mais l’écriture est aussi pensée de ce qu’elle colporte. Alors que le signifiant renvoie au signifié, l’écriture renvoie à la matérialité du mot ainsi qu’à son sens. Le nœud borroméen sert à Lacan à introduire la matière comme pensée et à l’inverse la pensée comme matière. Soit l’équivoque fondamentale du nœud qui est à la fois l’un (pensée mathématique) et l’autre (l’objet que l’on manipule).
Il n’y a pas de rapport sexuel, certes, sauf entre fantasmes. Et le fantasme est à noter avec l’accent que je lui donnais quand je remarquais que la géométrie – [Lacan écrit au tableau :] « l’âge et haut-maître hie » – que la géométrie est tissée de fantasmes, et du même coup toute science.
Exemple de l’équivoque de l’orthographe : « la géométrie » (écriture 1) s’écrit aussi « l’âge et haut-maître hie » (écriture 2). Vous noterez que Lacan écrit l’écriture 2 au tableau. Il fait le geste de la main en traçant la ligne de l’écriture 2.
Faire de la géométrie est aussi s’éloigner de la géométrie et se préoccuper de l’âge, ou aussi du maître quand il est haut. Quant au « hie », vous saurez qu’il s’agit de la dame formée d’un manche et d’une masse qui sert à enfoncer les pavés d’une rue. On l’appelle aussi « demoiselle » ou « mouton ». Je peux énoncer ce fantasme ainsi, parmi d’autres possibilités : « celui-ci qui se prétend haut-maître ne voit pas son âge qui le plombe alors qu’il roucoule auprès de cette demoiselle ». Nous sommes loin de la géométrie. Voilà en quoi la géométrie est tissée de fantasmes qui se bâtissent autour de ces diverses acceptions. Et Lacan, tirant la ficelle, ajoute, en quoi « toute science est aussi tissée. »
Nous avons vu qu’il n’y a pas d’écriture du rapport sexuel. Ici Lacan nuance « sauf entre fantasmes ». Donc il y a une exception au non rapport, c’est quand les fantasmes entrent en rapport entre eux : ici, nous dirions il y a rapport entre la géométrie, la dame, le maître et l’âge. Puissance de l’écriture quand l’orthographe se met à équivoquer. Puissance du fantasme quand il nous laisse à croire que le rapport sexuel pourrait s’écrire.
–