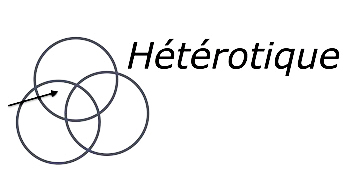Séminaire : Du trait à l’écrit – George-Henri Melenotte
Séance du 4 février 2019
–
Enfin, je saisis l’occasion de vous présenter une question qui trottine dans ma tête depuis quelques années : la question du trait. Dire que le trait fait question paraîtra abusif, pour peu que l’on se demande quelle est la question qu’il pose.
Je commencerai par celle-ci : à partir de quel moment le tracé d’un trait passe-t-il à la lettre pour qu’elle devienne lisible ?
Je vous suggère une petite expérience que je vais faire avec vous.
Je commence à tracer sur le papier une ligne et je vous demande de me dire à partir de quel moment le graphisme que je fais devient lisible, c’est-à-dire à partir de quel moment vous identifiez la lettre que je suis en train d’écrire. Pour que le test soit valable, il faut procéder sans que vous ayez la moindre idée de ce que j’ai l’intention de faire en traçant une ligne. Peut-être vais-je me contenter d’un gribouillis, d’une simple rature, à moins que ce ne soit un dessin, un visage qui m’est cher, ou bien une lettre de notre alphabet, mais vous ne devez pas rien savoir de plus sur mon intention.
Je commence : je fais le geste de tracer un trait, puis je donne à ce trait une évolution courbe qui, partant de la gauche, va vers la droite puis remonte pour faire une boucle et se prolonger bien au-delà vers le bas en une courbe concave vers le haut.
J’obtiens la lettre e.
Voici le résultat :
Figure 1 : lettre e
J’ai écrit la lettre e. Vous l’avez identifiée dès que la forme du trait a été assez avancée pour que vous puissiez la reconnaître. Je marque ici d’une croix le moment de la reconnaissance. J’appelle x cette croix de lisibilité.
Figure 2 : lettre e cochée de la croix de lisibilité x.
Si je prends le trait qui précède la reconnaissance, j’obtiens un graphisme que j’appelle a : Figure 3 : a
J’utilise le terme de graphisme pour dire que je ne sais pas comment qualifier a : s’agit-il d’un dessin ? Du dessin d’un poisson ? D’un œil ? Celui de Cléopâtre ? D’un insecte ? D’une larve ? d’une ligne dans un espace à trois dimensions ? a est un graphisme qui pourra tout aussi bien s’insérer dans un dessin que dans un signe.
Avec a, il est trop tôt pour dire si nous avons affaire à l’esquisse d’un dessin, donc d’une image, ou à l’esquisse d’une lettre, donc d’un symbole.
Comme a n’est qu’une étape du geste que je fais, il correspond à un instant donné t de ce geste. Comme le geste se poursuit une fois a tracé, il importe de lui donner un rythme temporel puisque, sans lui, il ne serait pas possible de repérer a. Le graphisme a qui s’arrête à x correspond à un temps t du geste de celui qui trace le trait.
Si je poursuis le trait après x, j’obtiens ceci : Figure 4 : graphisme que j’appelle b.
Je peux voir dans b le dessin d’un flagelle ou d’autres choses encore.
Ceci nous permet d’accéder à la lisibilité des deux graphismes. Si je les complète l’un par
l’autre, j’obtiens la lettre e que je peux lire. Je peux écrire cette opération ainsi : e = a + b.
C’est-à-dire que la lettre e s’obtient par l’adjonction de deux graphismes non identifiés : a etb.
Comme il y a au départ la page blanche, on peut repérer trois temps dans l’écriture de la
lettre :
Temps 1 : Page blanche, ou temps zéro.
Temps 2 : Temps du tracé de a.
Temps 3 : Temps du tracé de a + b : identification de la lettre e à partir de x.
Cette expérience terminée, un auteur est venu frapper à ma porte et vous allez voir en quoi. Il s’agit de Gerrit Noordjiz, typographe, créateur de caractères et auteur, ancien enseignant à l’Académie Royale des Beaux-Arts de La Haye, dans les Pays-Bas. Il est l’auteur d’un livre traduit en français : Le trait : une théorie de l’écriture, paru aux éditions Ypsilon en 2010. Il distingue l’écriture manuelle ou calligraphique de l’écriture dessinée ou typographiée. Dans notre petit exercice, c’est à la première que nous nous sommes référés.
Noordjiz part d’une analyse détaillée de la lecture. Lire une lettre revient à saisir d’emblée sa forme dans sa globalité. Ainsi, l’on parvient à identifier la lettre par l’appréhension visuelle de sa forme globale et non par celle de ses détails.
Je ne peux séparer l’une des parties de la lettre de son ensemble. Si je sépare de la lettre l’une de ses parties, je la perds puisqu’il ne me restera qu’un élément insuffisant pour reconnaître son unité. Si je m’en tiens au graphisme a, et même si je devine qu’il va s’agir de la lettre e, je fais obstacle à la vision globale de la lettre dont a n’est qu’une partie. Et je perds e tant que je m’en tiens au graphisme a. La forme du trait qui dessine la lettre ne peut se penser de façon autonome par rapport à la vision globale que l’on s’en fait. D’où la nécessaire vision globale de la forme de la lettre pour pouvoir la lire.
Toutefois, cette vision de la lettre comme prenant appui sur la perception globale de sa forme, présente des inconvénients. Si, dans sa théorie de l’écriture, Noordjiz préfère partir d’un autre point de vue que celui de la vision globale, s’il préfère partir du trait, c’est parce que le trait présente l’avantage d’inclure le geste de la main qui va le tracer. Quand je trace un trait, ma main l’accompagne et avec lui, tout le corps. Penser la lettre par le trait revient à lui donner chair.
Ceci ne vaut que pour l’écriture calligraphique. Ce n’est pas le cas du caractère typographié qui reste égal à lui-même sans avoir eu recours à la main.
D’un autre point de vue, le trait valorise la forme de la lettre. Effectué par le geste, toute une série de nuances et de finesses peuvent s’y glisser qui ne répondent plus à la fonction de reconnaissance de la vision globale. Nous pénétrons dans le monde de la calligraphie.
Noordjiz pose comme principe de son analyse que le trait est l’unité fondamentale de toute forme. Nous allons lui emboîter le pas et nous approcher de l’écriture par le biais du trait calligraphié qui emporte avec lui les qualités que nous venons de mentionner. Son étude du trait va comporter trois parties : le blanc, l’image du mot et enfin le rythme.
Le blanc tout d’abord. Sans le blanc, aucune écriture ne peut se percevoir. À toute écriture, le blanc est nécessaire. Comme le silence l’est à la musique avec son soupir. La lettre ne prend forme que par le blanc qui l’entoure. C’est par contraste avec le blanc, que se dessinent les volutes de la lettre qui autrement ne seraient pas visibles.
Le blanc a une autre fonction : il permet de relier les lettres entre elles. N’y aurait-il pas de blanc qu’une telle liaison serait impossible. Le blanc joue par ailleurs entre les lignes qui forment un paragraphe, entre les pages et les chapitres qui constituent le livre. Un rapport de proportion s’établit entre blanc et noir pour les régler de façon harmonieuse. Dans la petite expérience que nous avons faite, le blanc persiste aux trois étapes. Il est remarquable toutefois de constater que le temps I, ou temps zéro, celui de la page blanche, s’avère décisif et se retrouve d’une certaine manière dans les temps qui suivent.
L’image du mot se constitue à partir du VIIe siècle et son individualisation va permettre le développement de la lecture qui s’en trouvera facilité. Le mot ne s’en tient pas seulement à cette caractéristique d’avoir une image. Cette image va provoquer l’introduction de blancs qui va l’isoler des autres et en faciliter la lecture. Ces unités de mots ainsi séparées vont provoquer des discontinuités dans la phrase qui introduisent du rythme dans sa lecture. Le mot devient alors l’unité rythmique visuelle de la surface écrite.
–
De ce propos liminaire, on peut retenir une approche de l’écriture à partir du trait qui inclut le geste de la main et le corps qui suit. On mesure à ceci que l’invention de la typographie et la mise au point des procédés d’imprimerie jusqu’à notre ordinateur portable, vont rendre
caduc le procédé d’écriture à la main.
Nous allons conjecturer à partir de là que, lorsque Lacan parle d’écriture, il ne s’agit pas de l’écrit, mais du déplié du trait qui va de la feuille blanche jusqu’à l’accès à la lisibilité de la lettre, puis la lettre proprement dite. Puisqu’il faut se donner une période à partir de laquelle nous allons prendre en compte ce que Lacan entend par écriture, nous allons le faire à partir de l’un de ses tout derniers séminaires, Le Moment de conclure, entre 1977 et 1978.
Ces préliminaires étant posés, quelques remarques d’ordre général s’imposent. Elles portent sur cette période du séminaire où il parle moins, où les séances deviennent plus brèves et sont elles-mêmes parcourues de longs silences. Je vous renvoie à ce sujet à l’ouvrage de Claude Jaeglé, Le Portrait silencieux de Jacques Lacan qui décrit fort bien ces détails. Parallèlement à cela, le tableau noir du séminaire se meuble de dessins du nœud borroméen ou de tores, ou encore des opérations diverses que Lacan, avec l’aide de Soury, leur fait subir. Comme par un effet de corrélation, au fur et à mesure que Lacan parle moins, voire se tait ou raccourcit la durée de ses séances de séminaire, il dessine. Certes beaucoup a été dit sur cette période. La vulgate répandait à l’envi que Lacan devenait sénile, qu’il s’égarait dans la confusion de ses ronds de ficelles. On en rajoutait à qui mieux mieux pour discréditer ce qu’il apportait. Il est vrai que son séminaire se présentait alors sous un aspect plutôt rude.
On n’accorda pas assez d’attention au fait que le silence des séances courtes allait de pair avec les dessins borroméens et que cette parité relevait de l’écriture, soit de cette écriture faite de blanc, de silence, dans un rythme marqué par les figures du nœud dont chacune valait comme unité rythmique de son propos du moment.
Ce sera là l’hypothèse de ce séminaire : lorsque Lacan parle d’écriture, il ne parle pas de l’écrit, c’est-à-dire du résultat du geste d’écrire, mais de la formation de la lettre par le trait à partir de la page blanche. Je mettrai de pair page blanche et silence comme corrélats de l’écriture. Et nous verrons le style particulier des dernières séances de son séminaire comme marque de cette écriture. Celle-ci prévaudra comme geste, c’est-à-dire comme acte d’écrire qui engage le corps.
Je vais maintenant arriver à ce séminaire intitulé Le Moment de conclure, plus exactement à la séance du 20 décembre 1977. Et je m’en vais vous lire une phrase de Lacan, tirée de cette séance qui a servi de déclencheur à l’idée de faire séminaire cette année sur le trait et l’écriture.
La voici :
C’est pour ça que je dis que, ni dans ce que dit l’analysant, ni dans ce que dit l’analyste, il y a autre chose qu’écriture.
À extraire une phrase de son contexte, on s’expose au risque de lui faire dire n’importe quoi. Mais ici, apparaît une articulation subtile entre la parole (« ce que dit l’analysant, ce que dit l’analyste ») et l’écriture. Pour ce qui a trait à l’écriture, que ce soit dans ce que dit l’analysant, ou dans ce que dit l’analyste, « il y a autre chose que l’écriture ». La parole de l’un ou celle de l’autre ont en commun, et rien d’autre que cela, l’écriture. Soit le procès de la production de la lettre par le trait.
Nous ne serions qu’à un pas d’une série de propositions, comme celles-ci : « dire, c’est écrire », « parler, c’est écrire » ou bien encore : « dire, c’est lire », etc. Pour peu que l’on s’arrête sur les phrases souvent brèves et assertives de Lacan, ce qui ne leur enlève pas leur caractère elliptique, que dit-il ?
Dire est autre chose que parler.
Cette phrase ne concerne pas la lecture classique qui distinguerait l’énoncé de l’énonciation. Il ne s’agit pas ici d’un dire qui serait à l’étage de l‘énonciation par rapport à son énoncé. Si dire est autre chose que parler, alors, sautons le pas, et posons que dire, c’est écrire.
Cette simple proposition ouvre un champ considérable au propos de Lacan. Car, quelle serait la particularité d’un dire qui ne serait autre qu’un écrit ?
Et puis quoi, quelle mouche l’a piqué ? Vu qu’il se livre là à une manœuvre incroyable pour tout lecteur assidu de ses séminaires précédents. Quelle mouche le pique qui lui fait poser tout brutalement que, dans tout ce qui se dit, tant du côté de l’analysant que de l’analyste, il n’y a jamais au fond que de l’écriture ?
Suivons-le dans son propos :
L’analysant parle. Il fait de la poésie.
Comment lire ce « il fait de la poésie ». Je ne peux ici avancer qu’avec mes propres bésicles. « Il fait de la poésie », comme monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Faire de la poésie me paraît relever ici de la manœuvre en cours de Lacan. Quand il dit « Parler », la parole ne tombe plus sous la juridiction du signifiant, c’est-à-dire de la linguistique, que ce soit celle saussurienne de ses débuts ou celle lacanienne de sa linguisterie. Faire de la poésie relève de ce que Le Gaufey appelle dans son dernier ouvrage l’effet de sens. Parler c’est se trouver déporté par sa parole dans des déplacements du sens et donc dans des productions de sens qui étaient, au départ, insoupçonnables.
Si parler, c’est écrire, et si parler – il s’agit de la parole de l’analysant -, c’est faire de la poésie, alors la dimension poétique de la parole suppose une autre écriture possible que celle impliquée au départ dans la parole.
Je vais vous lire la suite à haute voix, parce que vous allez repérer à ce moment-là la façon qu’a Lacan d’introduire la coupure. Il parle de l’analysant qui fait de la poésie. Il poursuit :
Il fait de la poésie quand il y arrive… c’est peu fréquent – mais il est « art ». Je coupe parce que je veux pas dire « il est tard ».
« Il est art ». Ainsi dit, vous sentez le problème de diction de « art ». Si je lis en bon français : « il est art », je fais la liaison entre est et art, ce qui me fait dire : il est (tar). Ce qui consonne avec « il est tard ». Or, comme Lacan ne veut pas dire « il est tard », il va couper avant. En disant « il est art », il élude la liaison qui lui ferait dire « tar ». Il la coupe : « il est/art ». Par où l’on voit que la coupure est une opération d’écriture puisqu’elle porte sur la lettre t impliquée dans la lecture de « il est art ».
L’analyste, lui, tranche.
Le recours à l’analysant et à l’analyste se poursuit. Mais alors que, jusqu’à présent, l’accent avait été mis sur ce que chacun a en commun avec l’autre, (« ce qu’il dit n’est autre chose qu’écriture »), voilà que maintenant apparaît une distinction entre les deux : si l’analysant parle et fait quelquefois de la poésie, l’analyste, de son côté, « tranche ».
Cette formule surprend. S’agit-il d’un retour brutal de Lacan à une conception de l’interprétation analytique qui donnerait à l’analyste les pleins pouvoirs de trancher sur la bonne signification à donner à la parole de son analysant ? Nous nous retrouverions alors devant un Lacan en pleine régression par rapport à lui-même, revenu aux pratiques ipéistes qui donnaient à l’analyste le pouvoir de l’interprétation.
Pour peu que l’on décide d’écarter cette hypothèse, ce qui serait préserver un certain Lacan, que faire de ce qu’il dit quand il affirme : l’analyste tranche ?
Je l’entends comme ceci : l’analyste coupe. Ce n’est pas du même type de coupure que celle dont nous venons de parler avec l’élision du t. Alors de quel type de coupure s’agit-il lorsque c’est l’analyste qui « tranche » ?
Ce qu’il dit est coupure, c’est-à-dire participe de l’écriture, à ceci près que pour lui il équivoque sur l’orthographe.
C’est l’analyste qui parle, c’est-à-dire qu’il coupe, qu’il recourt à l’écriture. De quelle façon s’y prend-il ? Réponse : « pour lui, il équivoque sur l’orthographe. » Je vous propose de lire le « pour lui » comme « sans le savoir ». Ce n’est pas tant l’affirmation d’un point de vue que l’assertion qu’il fait quelque chose sans s’en rendre compte.
Que diable peut bien vouloir dire : « il équivoque sur l’orthographe » ?
Lacan avance ceci :
Il écrit différemment de façon à ce que de par la grâce de l’orthographe, d’une façon différente d’écrire, il sonne autre chose que ce qui est dit, que ce qui est dit avec l’intention de dire, c’est-à-dire consciemment, pour autant que la conscience aille bien loin.
Équivoquer sur l’orthographe revient à écrire quelque chose de façon différente que celle dont ça s’entend à un premier abord. On notera au passage la belle place que Lacan donne à l’orthographe : « de par la grâce de… ».
Il est difficile ici de s’en tenir à ce propos sans en fournir un exemple. Il y en a plusieurs dans ce séminaire. Je vais en prendre un qui me paraît l’un des plus significatifs à l’endroit de cette question de la coupure.
Si je prends l’expression « être humain », je la dis et je l’écris ainsi : être humain. Je me rends alors compte de ceci : dès lors que c’est écrit, « être humain » peut s’écrire de toute autre façon.
Ainsi, à l’écriture 1, répond l’écrit 1 : être humain.
Je peux proposer l’écriture 2 à laquelle répond l’écrit 2 : les trumains.Ou bien l’écriture 3 à laquelle répond l’écrit 3 : les trou mains.
Ainsi, si je fais sonner « être humain » à partir de l’écrit 1, qui correspond bien à ce qui est dit, avec l’intention de dire « être humain », il sonne autre chose dont je pourrai rendre compte avec les écrits 2 et 3.
Apparaît une nouvelle propriété de l’écriture qui n’a pas été mise en évidence jusque-là. C’est celle-ci : toute écriture est passage d’une écriture à une autre. Elle ne saurait jamais se fixer sur un écrit. Si écrit il y a, l’écrit ne demeure jamais que comme un cliché photographique qui fixe de façon arbitraire un procès de transformation en cours. Il n’y a pas une écriture maisdes écritures de la même parole.
Alors, équivoquer sur l’orthographe apparaît bien ici comme un constat qui porte sur l’écriture. Si l’analyste tranche, on l’a vu, c’est en rapportant le dit de son analysant à l’écrit. Mais il fait un geste de plus : il coupe sur toute possibilité d’orthographe univoque, celle qui reviendrait à poser qu’il n’y a qu’une seule façon d’écrire « être humain ». La coupure de son tranchant porte sur l’orthos graphein, la façon droite d’écrire qui ne peut tenir du fait de cette propriété de l’écriture de n’être jamais fixée sur une seule façon.
Comment saisir ce qu’orthographe veut dire, étape bien indispensable si l’on veut bien avoir une idée de la manière de la faire équivoquer ?
Le Trésor de la langue française propose pour orthographe cette définition : la manière d’écrire un mot de façon correcte. Le dictionnaire précisera, la manière, quelle qu’elle soit, d’écrire un mot. Ce « quelle qu’elle soit » n’est pas à entendre ici comme imposant la seule bonne manière d’écrire un mot, mais laissant entendre à l’inverse qu’il en existe plusieurs. S’il y a plusieurs manières d’écrire un mot, alors son orthographe peut équivoquer, soit être déclinée selon plusieurs manières de l’écrire. On se rapportera à ce sujet à l’exemple des trois écrits.
Dans le même dictionnaire, il y a cette autre définition : l’orthographe est l’ensemble des règles fixées par l’usage et la tradition qui régissent l’organisation des graphèmes, soit la manière d’écrire les mots d’une langue. En clair, l’orthographe ne se discute pas puisqu’elle vient de la tradition ou de l’usage plus que de la raison. Usage et tradition tiennent la bride lorsque j’effectue le geste de l’écriture de la lettre. Ma main n’est pas libre pour écrire un caractère parce qu’il est inscrit dans la tradition. Elle se plie à ce que lui dicte cette tradition pour imposer au trait les détours qui donneront forme à la lettre de façon reconnaissable par quiconque. Vous serez peut-être sensibles comme moi à la présence du mot graphème dans cette définition de l’orthographe. La référence à ce terme laisse entendre que le trait entre dans la définition de l’orthographe dans la mesure où lui est supposé cette qualité d’être organisé selon le parcours d’une figure imposée. Soit ce que le dictionnaire appelle l’organisation du graphème.
On en arrive à une double approche de ce que serait faire équivoquer l’orthographe :
1/ Faire jouer les écritures possibles de quelque manière que ce soit (cf. écritures 1, 2 et 3) de l’expression ou du mot.
2/ Faire jouer les graphèmes de façon à passer de la figure imposée de la lettre à une figure libre. Ici, on quitte le mot et l’on se cantonne à la production graphique de la lettre : le graphème.
Dans notre petite expérience du début, c’est bien de la seconde approche dont il a été question. Sans le savoir, nous faisions équivoquer le graphème censé écrire la lettre e. Et nous découvrions qu’à faire ainsi équivoquer la lettre, la partie a pouvait basculer aussi bien dans le dessin (celui du poisson, d’un œil) que dans le gribouillis, ou autre forme de graphisme. Michaux a connu une telle expérience de la lettre dont le graphisme dérape sous l’effet de la mescaline dans Misérable miracle.
En poursuivant la lecture du propos de Lacan dans cette séance du 20 décembre 1977, on en arrive à ce point où il prononce la phrase au principe de notre propos du jour :
C’est pour ça que je dis que, ni dans ce que dit l’analysant, ni dans ce que dit l’analyste, il y a autre chose qu’écriture.
Un dernier point avant que je ne m’arrête dans cette présentation d’aujourd’hui. Ce point a juste été effleuré au moment où fut évoqué l’accès à la lisibilité du trait. Soit le moment t à partir duquel, franchi x, un trait a pu devenir une figure lisible qui s’offre à sa reconnaissance comme lettre.
Ce problème de la lisibilité du trait se pose de façon différente selon qu’il s’agit de la reconnaissance du signe quand il apparaît (émergence de la lettre) ou selon qu’il s’agit du type d’écriture auquel on a affaire (cf. les trois écritures).
Question : si l’analyste tranche, en quoi est-ce qu’il tranche ? Lacan :
L’analyste tranche à lire ce qu’il en est de ce qu’il veut dire, si tant est que l’analyste sache ce que lui- même veut.
Il y a ici une délicatesse qui porte sur le second « il ». S’agit-il de l’analyste qui tranche à lire sur ce qu’il veut dire ? ou s’agit-il de l’analysant qui dit et sur lequel l’analyste intervient en tranchant à lire « ce qu’il en est de ce que l’analysant veut dire » ?
Il semble que ce soit bien la première option qui doive ici l’emporter. L’analyste tranche sur ce qu’il en est de ce qu’il veut dire. Ceci indique que c’est bien l’analyste qui veut dire. Je reprends l’exemple d’« être humain ». Quand Lacan tranche en écrivant « les trumains » ou « les trous mains », c’est bien lui qui tranche à lire ainsi l’expression.
Il ne sera pas difficile de décliner tous les avantages d’une telle décision (d’un tel tranchant, d’une telle coupure) : vider l’être humain de son être, ce n’est pas la première fois que Lacan tente de le faire. Effacer la dimension ontologique propre à cette acception (l’être humain) est plus que bienvenue. Et comme l’on sait le peu de sympathie qu’il porte à l’endroit de l’homme, il tranche sans regret pour nous orienter vers le côté passoire de l’homme (les trous mains), soit qu’il est plein de trous.
Si c’est bien l’analyste qui tranche à lire sur ce qu’il (lui, l’analyste) veut dire, c’est parce qu’il peut lui arriver de savoir ce qu’il veut. Si ce à quoi il a affaire dans ce que lui dit l’analysant n’est jamais qu’écritures, au pluriel s’entend, il lui revient à lui, l’analyste, de mettre à jour la diversité des possibles écritures situées dans ce qui se dit. On voit bien ainsi que le tranchant de l’analyste ne clôt pas l’affaire. Bien au contraire, par son acte, il ouvre à la lecture des possibilités insoupçonnées que lui offre l’écriture. Ce que Lacan ne manque pas de souligner quand il dit ceci :
Il y a beaucoup de jeu, au sens de liberté, dans tout cela. Ça joue, au sens que le mot a d’ordinaire.-