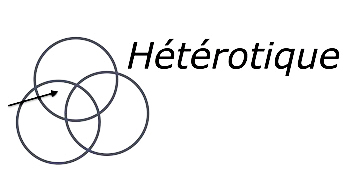Atelier deux analytiques du sexe
Première séance -10 janvier 2018 Strasbourg
–
Nous allons continuer le travail entrepris l’année dernière et cette fois-ci, comme indiqué dans les annonces que je vous ai fait parvenir, il s’agira de donner à la liberté la place particulière qu’elle prend dans l’analyse.
Cette place surprend car, tout habitués que nous sommes à l’usage soporifique et répétitif des mots, tant la communication est devenue dominante aujourd’hui, avec toute cette petite panoplie de mots dont l’utilisation est à ce point codée qu’il suffit d’en sortir pour se heurter à la plus vive incompréhension.
Aussi, quand on fête l’anniversaire de la manifestation où tous, dans un bel ensemble, clamaient : « je suis Charlie », je me souviens de la réaction de gêne que j’ai eue devant un tel unanimisme. Car je ne me reconnaissais nullement dans Charlie tout comme dans quiconque. Il me parut que lorsqu’une foule s’identifie à un nom propre, quel qu’il soit au demeurant, cela faisait plutôt froid dans le dos. Et il était étrange de constater que cette identification de masse à un nom propre, justifié par l’émotion et la réprobation devant le meurtre de journalistes, se faisait au nom de la liberté, chère paraît-il, au peuple français. Ce qui était étrange était qu’au nom de la liberté, on avait recours à la pire des aliénations.
Le dernier livre d’Allouch qui vient d’être publié va retenir cette année notre attention. Puisque, dans son titre, La scène lacanienne et son cercle magique, et dans son sous-titre, Des fous se soulèvent, il n’est aucunement fait mention de la liberté. Dès son introduction, avec son titre, La liberté, quoi la liberté ?, nous entrons dans le vif du sujet avec la phrase en exergue de Leopold Maria Panero, tiré d’un article de Raquel Capurro : « L’analyse […] doit être le double de la folie, son spectre, son fantôme, sa rédemption véritable ». Phrase surprenante car que peut bien signifier que l’analyse doive être le double de la folie, pire, son spectre, son fantôme ? Mais plus encore, qu’elle soit la rédemption véritable de la folie est pour le moins un propos obscur. Car l’on trouve dans l’usage de ce terme tout un fondement du christianisme qui trouve son socle dans le salut. Nous devions y revenir prochainement, je l’espère.
Je vous propose de commencer cette fois-ci par le déroulé d’une phrase qui commence ce livre et qui a certainement été mise à cette place dans un souci d’orientation de lecture par l’annonce des propositions du livre qui vont y être déployées.
Voici quatre propositions à entendre non pas comme autant d’énoncés fondés en bonne logique, mais plus trivialement comme ce qui se propose et se trouve donc ici posé : 1) La vie de tout un chacun est construite sur un acte de sa liberté. 2) En tant qu’elle s’exerce, cette liberté reçoit le nom de soulèvement. 3) Ce soulèvement est un dire que non à une aliénation. 4) Dire que non est se séparer. Liberté, soulèvement, aliénation, séparation. (8)
Vous remarquerez que cette introduction déroge à la construction classique d’un livre. Disons que d’entrée de jeu, les cartes sont abattues et que l’on se trouve pris en quelque sorte à la gorge par des affirmations rédigées comme des universelles : « La vie de tout un chacun est.. », « En tant que…, cette liberté reçoit le nom de… », « Ce soulèvement est … », « Dire que non est… ». Ces affirmations, au nombre de quatre, se donnent comme des propositions.
Elles présentent entre elles une cohésion telle qu’il paraît difficile de dissocier l’une des trois autres. À réduire comme il le fait ensuite ces propositions à quatre mots, Allouch propose pour l’analyse un programme marqué par son apparente simplicité. En écrivant d’emblée les choses ainsi, il affirme que traiter de la seule liberté ne convient pas. Les quatre mots tiennent ensemble. Et c’est ainsi que nous les aborderons.
S’il est trop tôt pour épiloguer sur elles, Allouch souligne leur caractère indémontable. Elles ne peuvent que susciter « au mieux » l’assentiment du lecteur. Assentir à ces propositions, dit- il, est alors à prendre au sens d’assentir à une musique, à un poème, à un tableau, à une performance. Or, on sait, TLF à l’appui, que l’assentiment est un acte de l’esprit par lequel on donne son adhésion à une idée, à une opinion que l’on reconnaît comme vraie. On peut aussi assentir à une œuvre d’art sans que la vérité soit sollicitée. À ce moment-là, l’assentiment est une adhésion à l’œuvre. Ainsi, on accueille un poème, celui-ci plutôt qu’un autre et l’on ne sait pas pourquoi. Le commun au poème et à la musique élus est qu’ils ne donnent pas leurs raisons.
Voici donc quatre propositions qui d’emblée se présentent dans un rapport problématique à la vérité. Elles ne trouvent de justification nulle part. Il s’agit, si l’on lit précisément le passage, de ce qui se propose, où le se tout comme le ce sont énigmatiques. Nous sortons ainsi des arcanes habituelles de la présentation des textes analytiques où souvent, faute d’une argumentation raisonnée, on a recours à la citation du maître (Lacan, Freud ou autre élu au trône) qui fonctionne comme détenteur de l’autorité de la chose dite ou écrite, ou à d’autres subterfuges, du genre recours à une vague clinique psychanalytique qui ne valorise jamais, sous couvert d’observation, que l’autorité du clinicien. Ici, il n’y a rien d’une telle ruse. Pas d’argument d’autorité. La chose est donnée sous la forme d’une série de quatre propositions posées là sans raison. Relèvent-elles de l’intuition ? De l’autorité du seul auteur ? Dans l’expression « ce qui se propose » apparaît un pont remarquable. Ce n’est plus Allouch, la personne d’Allouch, j’entends, mais ce ce qui se propose. Soit quelque chose qui nous paraîtrait inhabituel car nous ne savons pas ce qu’est ce ce et encore moins ce qui amène Allouch à se faire le secrétaire de ce que ce ce lui dicte. J’écris paraîtrait car n’avons-nous pas ici affaire à une énonciation qui se caractérise par son côté impersonnel ?
J’émettrai un hypothèse quant à la nature de ces propositions : elles sont le résultat de l’analyse, quand elle est menée jusqu’à son terme, c’est-à-dire quand elle accède à sa dimension traumatique.
Revenons sur le caractère indémontrable des propositions. Elles reposent sur la liberté donnée à chacun d’y assentir. Émettons l’hypothèse qu’elles s’avèrent démontrables, alors la force de leur démonstration va apparaître comme une atteinte à la liberté de chacun d’y assentir. L’emploi de la démonstration, on l’oublie trop souvent, est un moyen par lequel on force l’adhésion d’autrui à son propre propos. On ne lui laisse aucune possibilité de s’y opposer en le forçant à s’incliner devant la rigueur déployée. L’usage de la raison, en ce sens, plie l’assentiment et brise la liberté de s’y opposer. Dès lors, nous devons éviter de tomber dans l’illusion de croire que lesdites propositions relèvent de la logique propositionnelle et qu’elles sont dotées de valeurs de vérités. Comme y assentir revient à ne pas savoir si elles sont vraies ou pas, l’assentiment revient plutôt à opter pour leur vérité sans exiger une quelconque garantie à ce choix. Donner son assentiment témoigne d’un usage de la liberté que se donne tout un chacun de considérer ces propositions comme vraies – ou pas. Assentir est s’y engager sans certitude. Ceci n’est pas sans évoquer l’illumination qui se pose comme un savoir immédiat et silencieux qui ne repose sur aucune certitude.
Par ce propos, me voilà ainsi en plein exercice de la liberté. Par sa façon d’avancer ces propositions, Allouch s’adresse à notre liberté d’y assentir. Il le fait à partir d’un point de la sienne propre, puisque ce qu’il avance n’est pas de son fait mais de ce qui se propose et dont il se fait le secrétaire.
Que dire de la première proposition ? Et de la deuxième ? Et puis de chacune des dernières ? Je les reprends :
1) La vie de tout un chacun est construite sur un acte de sa liberté.
2) En tant qu’elle s’exerce, cette liberté reçoit le nom de soulèvement. 3) Ce soulèvement est un dire que non à une aliénation.
4) Dire que non est se séparer.
Vous voyez que présentées ainsi, il est difficile de les prendre autrement que comme une série de propositions axiomatiques qui ne sont pas forcément vraies mais qui servent de point de départ à partir desquelles il va être possible de construire un développement.
Y a-t-il dans cette série prééminence de l’une sur les trois autres ? De la première sans aucun doute, puisque c’est d’elle que les trois autres dépendent. Une nouvelle écriture de cette première proposition se retrouve en page 13 :
La vie de tout un chacun est de part en part (non pas tout entière) construite sur un acte de sa liberté.
Le « de part en part » qui a été rajouté introduit une nuance qui n’existait pas dans la première formulation. On perce avec une flèche une pomme de part en part. C’est dire qu’on la traverse. Ici, si la vie est de part en part construite sur un acte de liberté, c’est que de tout son long, la vie se construit à partir de cet acte.
Qu’entendre par acte de sa liberté ? Voici une courte histoire où il est question de ma liberté. Ce devait être en 1992. Je me souviens de ce moment particulier où je glissais l’enveloppe dans une boîte aux lettres. Ce devait être à Strasbourg, dans le quartier du Neudorf. La lettre que je lâchais tomba dans la boîte en faisant le bruit mat du papier quand il cogne le fond. Après l’avoir laissée tomber, je me suis dit que, dorénavant, la vie, ma vie, ne serait plus pareille. Et je ne me suis pas trompé. Le temps qui s’est depuis passé m’a permis de confirmer que ce simple geste l’avait profondément modifiée. On trouve encore trace de ce que contenait l’enveloppe dans le numéro 7, 1995-96, de l’Unebévue. L’article s’intitulait Attention !Déviation. Il dénonçait l’initiative prise en cette année 1992 par un groupe local d’organiser une journée sur le thème L’oralité à Strasbourg. Dans ce texte, un peu courroucé part l’ineptie du titre, je m’interrogeais sur le rapport qu’il pouvait y avoir entre la pulsion orale et la ville de Strasbourg. En rendant ainsi public mon refus de poursuivre dans la voie proposée par ce groupe je rompais mes attaches avec une tradition strasbourgeoise menée par Lucien Israel et Moustapha Safouan chargés par Lacan de venir coloniser les marches de l’Est. Les années qui suivirent me montrèrent à quel point tout acte de liberté, là il s’agissait bien de la mienne, suppose que l’on en paye le prix. Mais mieux encore, cet acte me désentrava de la tutelle exercée par la colle d’un groupe local. Il m’apparut comme effet d’une analyse menée jusqu’à son terme. Libéré des liens symptomatiques qui me faisaient poser les relations diverses que je pouvais entretenir avec mes collègues en termes d’appartenance, je me séparais d’eux et pouvais enfin goûter à la joie de pouvoir travailler avec celles et ceux qui avaient opté pour une saisie dynamique de l’analyse.
La liberté quand elle se pose en acte ne s’acquiert que par un prix. Un tribut qui s’offre immanquablement au point que l’on ne mesure pas, au moment où se produit cet acte, quelle peut être l’étendue du prix à payer. Mais le signe, je dirais la signature de cet acte, est son prix qui se présente toujours sous forme d’une perte dommageable, d’une addition dont au montant disproportionné. Ce pourra être la vie même. Comme Foucault le décrit à propos du soulèvement, mieux vaut mourir que mourir, perdre la vie libre que se maintenir dans une vie aliénée qui est déjà la mort. Cela suppose le choix du risque contre la tranquillité assoupie et sans force du quotidien benêt., le choix de l’océan de l’intranquillité de Pessoa.
L’homme que l’on voit sur cette photo s’appelle Fortuno Samano. Il fume un cigare avant d’être fusillé (Anonyme mexicain, Mexico, 1917, Secretaria de cultura, INAH, Sinafo, fn, Mexico.) Nous sommes en pleine révolution mexicaine. Dans quelques secondes, cet homme va mourir sous les balles. Il fume son cigare, il sourit, son allure dégingandée ne manqua pas d’élégance. Il accepte la mort sans regret de s’être soulevé. Il va partir ainsi dans mort, la tête haute quand son chapeau tombera. La seconde photographie montre l’exécution dans sa sèche brutalité. Les hommes fauchés par les balles ne sont plus reconnaissables. Sur un site, on trouve que ces photos sont d’un certain Augustin Victor Casasola.
Plus près de nous, cette photo des fusillés communards en 1871, à Paris lors de la Semaine sanglante :
Cette photo ne vous est pas présentée pour vous faire jouir de l’horreur qu’elle suscite, ni pour vous inciter à la révolte. Elle montre ceux qui ont fait leur cette devise dont il a été fait mention plus tôt : mourir plutôt que mourir. Ils ont fait le « bon choix de la mort.» Je vous livre ce passage tiré du texte de Foucault : Inutile de se soulever ? à titre de rappel d’un travail antérieur effectué en 2016 :
En revanche, il me paraît énigmatique, parce que justement aller absolument à l’encontre de cette espèce de calcul évident, simple, en fait qui consiste à dire, je préfère mourir plutôt que de mourir, je préfère mourir sous les balles plutôt que de mourir ici, je préfère mourir aujourd’hui en me soulevant plutôt que de végéter sous la coupe du maître dont je suis l’esclave. (…) Ce « mourir plutôt que végéter », (…) est un « bon choix de la mort ». (« Inutile de se soulever ? », 10)
Je reviens maintenant à la petite histoire de boîte aux lettres que je viens de vous raconter
Cet acte de ma liberté que je rapporte m’a amené à le reconnaître dans d’autres épisodes de ma vie où, il se reproduisait, toujours dans le même sens, toujours dans le sens de la séparation d’avec ce qui pouvait m’avoir aliéné. Et, si, à chaque fois cette aliénation se présentait sous des formes différentes, il n’en demeurait pas moins que la liberté s’y manifestait en acte, sous la forme d’un soulèvement. Aussi, pour peu que je reprenne encore une fois cette première proposition : « La vie de tout un chacun est de part en part (non pas tout entière) construite sur un acte de sa liberté. », on perçoit que cette proposition vaut pour tous. Autrement dit, tout un chacun construit sa vie sur un acte de sa liberté. Cela indique que, chez chacun, cette liberté est en puissance et que, quand cette puissance passe à l’acte, la liberté agit alors, cet acte s’appelant soulèvement. Un autre aspect s’entrevoit dans cette formule, c’est le caractère méconnu de cette liberté que chacun recèle. Chacun ne sait pas à quel point la liberté est ce à quoi il ne cesse d’aspirer, qui le mène sur la voie de la séparation d’avec ce qui l’aliène. Qu’il y réussisse est une autre affaire. Mais cette liberté ne cesse de frapper à la porte, de faire signe. Elle est bien une nécessité que chacun recèle comme une force insoupçonnée et indestructible.
On pourra ici critiquer l’emploi du terme force pour ses relents métaphysiques. Mais il vient de la lecture d’un texte de Georges-Didi Huberman qui cite, à propos du soulèvement, un poème. Didi Huberman écrit que l’on ne se soulève pas «sans une certaine force» (Soulèvement, 20). Pour qu’elle puisse s’exprimer, encore convient-il de lui donner une certaine forme. Ce sera le poème suivant de Jorge Luis Borges, qui conjugue la force et la forme, poème qui s’appelle Les Justes :
Un homme qui cultive son jardin, comme le souhaitait Voltaire,
Celui qui est reconnaissant à la musique d’exister,
Celui qui découvre avec bonheur une étymologie.
Deux employés qui dans un café du Sud jouent une modeste partie d’échecs. Le céramiste qui édite une couleur ou une forme.
Le typographe qui compose bien cette page, qui peut-être ne lui plaît pas. Une femme et un homme qui lisent les derniers tercets d’un certain chant. Celui qui caresse un animal endormi.
Celui qui justifie ou cherche à justifier le mal qu’on lui fait.
Celui qui préfère que les autres aient raison. Tous ceux-là, qui s’ignorent, sauvent le monde.
Dans le soulèvement, c’est la liberté qui se soulève. Ce n’est pas, comme on le pense trop souvent, l’individu, la personne qui se lève, c’est la liberté en lui qui se soulève, qui le soulève. Prenons la troisième proposition: «Ce soulèvement est un dire que non à l’aliénation. » On y lit que l’on ne se soulève jamais que par une déclaration, une énonciation. Ainsi, le lapsus, l’acte manqué, le rêve, l’oubli s’inscrivent-ils comme autant d’actes de liberté qui procèdent du dire. Une précision toutefois s’avère utile. Est-ce dire que dans l’acte manqué, réside un acte de liberté ? Sans aucun doute. Mais, une remarque de bas de page du livre d’Allouch va se montrer utile. Se référant au terme allemand Fehlleistung, trouvé dans l’ouvrage de Paul Federn, « Investissement du moi et actes manqués », traduit récemment en français par Catherine Haussone et Benjamin Levy, les traducteurs indiquent qu’une oreille allemande exercée entend dans ce terme le manque d’un acte. Allouch voit dans leur remarque un précieux conseil technique : là où se présente un acte manqué, il convient de chercher l’acte qui manque. Soit l’acte de liberté qui vient ici à manquer et qui sonne l’alarme au sujet inattentif qui le produit. Dans la liste ainsi donnée, lapsus, actes manqués, oublis, rêves, ce ne sont pas des actes de liberté auxquels on a affaire mais à des actes qui témoignent d’actes de liberté comme manquants. Ceci nous montre à quel point dès lors que la subjectivité est bridée par une aliénation qui bride l’expression de la liberté, celle- ci s’infiltre nécessairement dans les filets du langage pour y nicher des discordances qui témoignent de l’aspiration à la liberté qui anime ce sujet. Quand la langue trébuche, le caillou sur lequel elle fait ce faux-pas est celui de la liberté.
Ce n’est pas un dire non, mais que non, comme quand l’on dit que non, décidément, ça suffit ! Ou quant l’on répond que non, les choses n’en iront pas ainsi. Autant dire non est nier, autant dire que non porte le « que » qui indique que, dorénavant, c’est fini, non les choses ne continueront pas ainsi. Ce que porte la fracture de l’événement. On voit que, après la troisième proposition qui affirme que l’on ne dit jamais que non à une aliénation, vient la quatrième proposition qui donne une définition de ce dire que non : Dire que non est se séparer. On se sépare de la vie antérieure, de sa famille, de ses amis, de ses habitudes, de ses aspirations, de son ambition. On va alors vers le dénuement et la solitude. On est sans direction, mais l’on sait qu’il faut se séparer de ce que l’on quitte.
Georges Didi Huberman va prendre appui sur deux petits travaux de Francisco Goya pour « donner forme à cette lumineuse exclamation », venue une vingtaine d’années après la Révolution française qui embrasa l’Europe. La première montre un porte-faix pliant sous le poids de la charge (vers 1812-1823, Grattoir, pinceau et lavis d’encre sépia sur papier vergé blanc, Musée du Louvre, Paris)
La seconde illustration, toujours de Goya, s’intitule «No haras nada con clamar (tu n’arriveras à rien en criant), vers 1814-1817, Dessin à l’encre sur papier, collection particulière). Celle-ci montre l’ouvrier clamant « pour rien, c’est-à-dire pour ne rien obtenir. Il crie en pure perte apparemment. Il n’empêche que ce qui s’exprime ainsi, c’est sa révolte. Didi-Huberman écrit : « Voilà le geste même, ce geste du soulèvement. » Goya montre que ce qui importe n’est pas la visée du geste, mais plutôt le geste en lui-même. Autrement dit, le soulèvement, au moment où il se produit, n’a pas de programme. En ce sens, il est sans projet, il n’est pas révolutionnaire. Il pourra l’être, le devenir, mais dans un deuxième temps.
Didi-Huberman commente ce geste un peu plus loin dans son texte :
Le soulèvement est un geste sans fin (je le lis aussi comme sans finalité), sans cesse recommencé, souverain comme peut-être dit souverain le désir lui-même ou cette pulsion, cette « poussée de liberté » (Freiheitsdrang) dont a pu parler Sigmund Freud1. (Soulèvement, 17)
Ainsi que vous avez pu vous en rendre compte, lors de l’un de mes derniers envois, je vous ai fait parvenir cet extraordinaire morceau de bravoure qu’est la danse du soulèvement, le Krump. Cette danse vient des quartiers pauvres et dits difficiles de Los Angeles2. Cette danse exprime sans détour la violence de ceux qui se lèvent contre la répression policière, non sans une certaine sauvagerie valorisée par la musique de Rameau, dans les Indes galantes (Les sauvages). Le dire que non passe par l’image mais aussi par la danse.
Il est un point sur lequel il revient de s’arrêter car pour peu que l’on prête intérêt au travail d’Allouch depuis plusieurs années et que l’on donne à ce travail son assentiment, la refonte du vocabulaire analytique est au centre de ses élaborations. Sans en dresser la liste, on conviendra que l’utilisation faite de ces quelques mots, « soulèvement », « liberté » ou « aliénation », pour nous en tenir aux simples termes employés dans ses quatre propositions, montre l’emprunt fait à d’autres champs que le champ freudien, au champ politique essentiellement. Est-ce si surprenant quand on découvre que l’emprunt de ces termes lui vient de Foucault, traitant de « spiritualité politique » ?
1 Lors de l’atelier, Claire Metz nous a indiqué avoir trouvé ce terme de Freud dans Malaise dans la culture.
2 Dominique –Anne Offner rapporte que cette danse est une réplique aux violences policières qui se sont exercées sur les habitants de ces quartiers. Cette dans n’est nullement un spectacle, comme le hip-hop. Elle garde un côté confidentiel.
Prenons le terme de liberté dans son rapport au soulèvement. Et voyons ce que Foucault en dit. Toujours, dans Inutile de se soulever ?, voici trois passages que l’on y trouve et que je vous rapporte maintenant :
Le problème encore une fois ce n’était pas de savoir ce qu’il y avait dans la tête des leaders du mouvement (il parle du mouvement iranien), c’était de savoir comment vivaient là-bas ces gens qui littéralement faisaient la révolution, me semble-t-il, pour leur propre compte. (« Inutile de se soulever ? », 8)
Derrière cette simple remarque de Foucault, émerge l’idée somme toute banale que les gens, comme il dit, ne font pas la révolution conformément aux souhaits de leurs leaders, mais la font pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Cette critique des leaders et de leur tentative de récupération du soulèvement a été très importante pour Foucault tant il fut l’objet de cabales menées par ses pairs qui le présentaient comme un valet de l’imam Khomeiny. Je pense au philosophe Jean-François Revel notamment. Disons que la liberté est conquise par le soulèvement de ceux qui font de cette levée leur affaire.
Seconde référence :
Je me rapproche à la vitesse grand V (…) pour sa conception de la liberté (…) de
Sartre. (« Inutile de se soulever ? », 16)
Il est difficile de savoir ce qu’entend Foucault dans cette affirmation. Mais il y a chez Sartre l’idée de la liberté comme acte. Être libre, c’est agir, et agir sert à modifier la figure du monde. Tels sont aussi les termes du soulèvement au sens foucaldien. Pas de liberté sans acte, donc pas de liberté sans soulèvement, pas de soulèvement qui n’ait comme visée la modification de la figure du monde.
Enfin, troisième référence. Si la liberté se traduit en acte, Foucault insiste pour bâtir son projet dans la visée de multiplier les occasions de se soulever en acte. Le champ d’exercice du soulèvement s’en trouve étonnamment élargi puisqu’il atteint des domaines aussi divers que la famille, le sexe, la pédagogie, le maniement d’une certaine information :
Mon projet c’est en de effet multiplier partout, enfin partout où c’est possible, de multiplier les occasions de se soulever, par rapport au réel qui nous est donné, et de se soulever pas forcément ni toujours sous la forme du soulèvement iranien, avec ses quinze millions de personnes dans la rue, etc. On peut se soulever contre un type de rapport familial, contre un rapport sexuel, on peut se soulever contre une forme de pédagogie, on peut se soulever contre un type d’information. (« Inutile de se soulever ? », 17)
Aussi retrouve-t-on ici certaines caractéristiques avancées dans les quatre propositions qui nous retiennent aujourd’hui. Je les rappelle :
1) La vie de tout un chacun est construite sur un acte de sa liberté.
2) En tant qu’elle s’exerce, cette liberté reçoit le nom de soulèvement. 3) Ce soulèvement est un dire que non à une aliénation.
4) Dire que non est se séparer.
Le soulèvement se dresse, nous dit Foucault, contre le réel qui nous est donné. Ici, Allouch précise qu’il est un dire que non à l’aliénation. Si nous partons du réel, de ce qui nous est donné, ce réel est aliénant en tant que, lorsque l’on vient au monde, c’est dans lui que l’on tombe. On ne le choisit pas. Il nous est donné un point, c’est tout. Il s’empare de nous sans contrepartie. Il nous moule, nous modèle, nous détermine, nous donne une identité, construit notre vie. Mais comme le montre la gravure du porte-faix de Goya, il peut peser au point de se montrer écrasant. L’acte de la liberté du sujet le libère de cette charge. Il se produira une fois et traversera toute sa vie. Cet acte change pour lui la configuration du monde puisque le voilà, ce monde, délesté de sa charge et, de ce fait, beaucoup plus praticable. Ce monde change dans les domaines dont Foucault dresse une courte liste : familial, sexuel, éducatif, informatif. Mais ce sera tout aussi bien le domaine religieux, politique, artistique ou autre encore. Dans sa diversité, à chaque fois, ce réel aliénant offre l’occasion de se soulever.
Dans les mouvements poétiques, on trouve trace du soulèvement. En témoigne cette affiche du mouvement dada : DADA soulève TOUT, au texte édifiant.
On notera que Dada soulève tout. Rien ne lui échappe. L’ordre établi vole en éclats au passage de la moulinette Dada qui ne laisse aucune prise à la moindre résistance. Rien ne lui échappe. La liberté qui se manifeste ici est absolue puisqu’elle ne se donne aucune limite. Le soulèvement Dada est total.
Une des formes par lesquelles se manifeste le soulèvement est la désobéissance. Dans Désobéir, Frédéric Gros écrit sur La Boétie. Que nous dit ce dernier ? « Ce qui caractérise la liberté, c’est qu’il suffit de la désirer pour aussitôt l’obtenir. » De ce point de vue, être libre, c’est vouloir être libre. Or, comme la liberté, toujours selon La Boétie, est ce que les hommes ne désirent pas, il faut tenir compte du désir d’obéir qui les anime. Survient une nouvelle définition de la liberté : « Être libre, c’est s’émanciper de son désir d’obéir. » (61) Dans La promenade de Thoreau, Frédéric Gros raconte une promenade de Henry David Thoreau. Celui-ci a fait le pari de vivre seul en autarcie, de faire l’expérience d’une « vie naturelle », dans les bois. Il a construit lui-même sa propre cabane où il habite près d’un lac. Arrivé en ville pour chercher des chaussures, l’agent fiscal l’interpelle et le met en demeure de payer ses impôts. Thoreau refuse tout net, avançant qu’il ne saurait financer l’injuste guerre avec le Mexique qui va aboutir à l’annexion du Texas. Nous sommes au mois de juillet 1846. Il se retrouve en prison. La nouvelle se répand dans la ville et produit une grande émotion. Après une intervention de proches de sa famille et d’amis, il est libéré. Et cet homme, à peine sorti de prison, s’en ira grimper sur la colline proche pour cueillir des airelles.
C’est peut-être au moment où Foucault écrit que l’on peut se soulever contre un rapport sexuel qu’il s’approche le plus de ce que Lacan dira de la liberté. Dans la séance du 17 février 1971, du séminaire D’un discours qui ne serait pas du semblant, Lacan dit ceci :
Les personnes sérieuses…je reprends ce que je suis en train de dire, auxquelles se proposent ces solutions élégantes qui seraient l’apprivoisement du phallus…ben c’est curieux, c’est elles qui se refusent. Et pourquoi, sinon pour préserver ce qui s’appelle la liberté, en tant qu’elle est précisément identique à cette non-existence du rapport sexuel. (Lacan séance du 17 février 1971, D’un discours qui ne serait pas du semblant.)
On lit que la liberté est identique à la non-existence du rapport sexuel. Qu’est-ce à dire ? Pourquoi l’inexistence du rapport sexuel serait identique à la liberté ? Allouch reprend cette définition dans Pourquoi y a-t-il de l’excitation sexuelle plutôt que rien ? (47) Citant la séance du 17 février 1971 de Lacan, il poursuit :
Et, c’est, proposerais-je, de cette liberté liée à la non existence du rapport sexuel que prend son envol ce qui peut, avec Foucault, être dénommé « soulèvement ». Un tel soulèvement serait, dans l’analytique du rapport, le pendant du désir dans celle de l’objet a.(47)
Voilà, ayant posé ces quelques phrases, vous ressentirez comme moi, leur difficulté, voire leur caractère vertigineux. Toutefois, on peut très bien ne pas se laisser impressionner par elles et tenter de les aborder de façon plus dépliée. Pourquoi ne raisonnerait-on pas en posant que l’inexistence du rapport sexuel établit l’Autre comme lieu déserté, comme coquille vide, qui libère le sujet de son nécessaire rapport à ce même Autre ? Et qu’ainsi débarrassé de l’emprise de cet Autre, tant par sa jouissance, que par le rapport sexuel, que par l’Autre de l’Autre, c’est-à-dire Dieu, il ne reste au sujet que sa liberté. Elle le plonge dans un état particulier d’excitation non exempte d’une connotation mystique. Allouch parle d’une nouvelle mystique, plus proche de celle de Jean de la Croix que de sainte Thérèse d’Avila.
Partons de ce traumatisme lorsque l’Autre s’avère marqué par la triple inexistence de la jouissance de l’Autre, du rapport sexuel et de l’Autre de l’Autre. Ceci n’est pas sans effet puisque ce qui s’ensuit dans l’expérience analytique est celle de l’émergence d’un certain désir (48). Ce désir particulier se spécifie d’être désir d’une absence de désir du rapport sexuel.
L’émergence de ce désir a un effet : il ouvre un gouffre dans l’érotique (47). Quand Allouch parle de nouvelle mystique, c’est sur un mode interrogatif. Que serait cette nouvelle mystique sans Dieu ?
Y aurait-il lieu, à ce propos, d’évoquer une nouvelle mystique ? Une mystique plus proche de Saint Jean de la Croix que de Sainte Thérèse d’Avila ? (47)
Il cite un article de Jacques Le Brun, paru dans la revue Essaim 2001/2002, n°8, intitulé « Une réédition, Le Saint Jean de la Croix de Jean Baruzi. » (163-170) Dans cet article, Jacques Le Brun montre combien Baruzi développe au sujet de Saint Jean de la Croix une thèse : « La mystique recèle une pensée.» Aussi la tâche du philosophe et de l’historien est-elle de retrouver dans le texte mystique « la pensée profonde qui s’élabore. » Pour ce faire, il doit aller « au-delà de l’apparence ». Aussi Baruzi pose-t-il Jean de la Croix comme un logicien du mysticisme.
Pour atteindre que qui est nommé « le triomphe de la notion », encore faut-il accéder à « l’échec définitif de l’image. » Ledit triomphe de la notion suppose un impitoyable travail de la négation, « un total rejet des appréhensions distinctes ». Il s’agit d’un « non-sentir », d’un « non-voir ». On reconnaît dans l’âme le « vide de toutes les choses.»
Seront ainsi rejetés les appréhensions distinctes, « tout le troublant cortège des visions, des révélations et des paroles » que Sainte Thérèse laissa vivre au fond d’elle-même. Cette distinction entre Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d’Avila va tracer « dans l’histoire de la mystique moderne et de toute la pensée occidentale, une frontière discriminante. »
On saisit ici comment Allouch privilégie dans sa nouvelle mystique le « non-sentir », « le non-voir » qui rejette les visions, les révélations et les paroles. Va-t-il dans le sens de la promotion de la notion aux dépens de l’image ? S’oriente-t-il vers le vide de toutes les choses ? Il semble bien.
Pour Baruzi, la nuit est le symbole même de la mystique de Saint Jean de la Croix. Cet « unique symbole » lui permettait d’atteindre la profondeur de l’expérience et l’expérience même. La nuit en effet, écrit Le Brun, quelle que soit la richesse de ses significations, est, il cite Baruzi, « incommensurable avec toutes ses significations et mérite d’être appelée au sens technique du mot, un symbole » (p. 372). La nuit convient à cette mystique comme symbole, elle qui préconise « le non-voir » et « le non-sentir ». La nuit correspond à cet usage de la négation et à son impitoyable travail. C’est ce qui amène Le Brun à écrire : « « Solitude » (p. 208, 278), « dénuement » (p. 414), « oubli » (p. 322), « mort intérieure » (p. 363), marquent le travail de la négation du sens du voir et du goût.»
Pour peu que cette nouvelle mystique, si proche de celle de Saint Jean de la Croix, soit à l’œuvre avec l’érotique de la deuxième analytique du sexe, on voit à quoi mène ce travail de la négation du sens du voir et du goût. Solitude, dénuement, oubli, mort intérieure rythment alors avec liberté. Ces perspectives ne paraissent guère engageantes. L’analyse, celle-là même qui prône le soulèvement comme ce qui la scande, ne se termine pas sur des matins qui chantent. Toutefois, il est aisé de donner accueil à ces termes issus de la plume de Le Brun, éclairée par la lecture par Baruzi des écrits de Saint Jean de la Croix. Cette étonnante mystique sans Dieu est toute spirituelle du fait de la négation dont elle procède de la sensualité. La sensualité qui se trouve niée, exclue de cette mystique n’est pas prude. Elle se manifeste par ceci qui, pour nous relève du plus grand intérêt : elle s’exerce sans objet a, soit sans les éléments de la série des objets pulsionnels, une mystique sans regard, non contemplative, sans voix, donc silencieuse ou sans paroles. Pour le reste, on déclinera selon l’objet les formes qu’elle pourra prendre.
Encore une remarque de Jacques Le Brun : Il est un autre aspect, écrit-il, par lequel à la fois l’œuvre de Jean de la Croix et la thèse que lui consacra Baruzi en 1924 constituent deux
témoignages essentiels sur la modernité du XVIIe siècle et sur celle du XXe siècle : la découverte de l’absence de Dieu et de la « solitude » de l’homme (cf. l’analyse de la « Soledad », de la solitude, par Baruzi, p. 156, 208, 366, 702, etc.).
Voilà, je m’arrête là pour aujourd’hui. Nous nous retrouverons le 24 janvier prochain. –