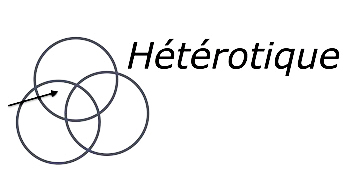Atelier deux analytiques du sexe
Cinquième séance – 14 mars 2018 Strasbourg
–
L’influence que l’on exerce ne peut jamais être un pouvoir que l’on impose.
–
J’ai choisi cette phrase de Foucault comme titre pour aujourd’hui car il me paraît utile de vous dire combien il m’est arrivé d’éprouver le reproche à moi adressé d’imposer une idée ou une façon de faire à d’autres, alors que je ne me souciais guère d’autre chose que d’une mise au travail effective de leur part. Et c’est souvent sous prétexte que j’imposais que l’on m’a renvoyé un refus « salvateur » de la personne qui, en fait, décidait le plus souvent de ne pas sortir des ses a priori. C’est donc dans cette phrase de Foucault, parlant de Lacan, que j’ai trouvé cette légitime et combien féconde distinction entre imposition et influence. Car, vous le ressentirez comme moi, l’influence indique que l’on s’adresse à la liberté d’autrui et non à son obéissance. Non pas que l’on se laisse influencer, mais que l’influence, comme le montre les diagrammes d’Allouch, relève d’un attrait pour une scène particulière, la scène lacanienne.
L’influence est librement consentie, elle témoigne d’une ouverture sur l’expérience d’autrui sans que celui-ci cherche à vous imposer quoi que ce soit.
Ceci me permet de faire une première transition en rappelant l’objet du travail de notre atelier. Son objet est le traitement de la liberté tel qu’il apparaît dans le dernier livre d’Allouch. Or, pour peu que l’on lise ses propositions actuelles, on repère une ligne qui s’est déjà
depuis longtemps, ligne qu’il ne cesse de confirmer dans chacune de ses nouvelles publications. Il fait sienne cette proposition : la psychanalyse sera foucaldienne ou ne sera pas. Guy Casadamont rapporte qu’il existe une autre formule: la psychanalyse sera foucaldienne ou ne sera plus. Dès lors y a-t-il lieu, dans le travail de cet atelier de revenir aux textes de Foucault susceptibles d’éclairer notre lanterne. Et justement, il en est un qui réclame notre arrêt. C’est un article de Foucault publié dans le Corriere della sera. Il date du 11 septembre 1981.
Foucault y parle de Lacan et de la liberté, justement. Le titre de son article est : Lacan, il « liberatore » delle psichanalisi, Lacan le « libérateur » de la psychanalyse. Foucault y répond à des questions de Jacques Nobecourt. Voici Lacan campé par Foucault comme libérateur. Lacan donnant à la psychanalyse sa liberté. Mais quoi, dans quelle prison était-elle incarcérée avant qu’il n’intervienne ? Et comment prendre les guillemets qui entourent le qualificatif de « libérateur » ? Est-ce ironique ? Ou est-ce bien la façon dont Foucault perçoit Lacan dans son intervention dans le champ freudien ? Non pas tant comme un libérateur que comme celui qui a introduit la liberté dans ce champ en lui donnant son statut de concept analytique.
Foucault donne ses raisons. À une question de Nobecourt qui l’interroge pour savoir si, selon lui, Lacan était révolutionnaire, Foucault répond que Lacan aurait refusé un tel qualificatif. Il précise :
Il voulait simplement être « psychanalyste ». Ce qui supposait à ses yeux une rupture violente avec tout ce qui tendait à faire dépendre la psychanalyse de la psychiatrie ou à en faire un chapitre sophistiqué de la psychologie. Il voulait soustraire la psychanalyse à la proximité, qu’il considérait comme dangereuse, de la médecine et des institutions médicales.(DE, II, 204)
Première leçon à retenir de cet hommage au libérateur Lacan : libérer la psychanalyse, comme le fait Lacan, de l’emprise médicale en pratiquant une « rupture violente » avec elle. De même doit-il en aller avec la psychologie lorsqu’elle tente de faire entrer la psychanalyse comme chapitre « sophistiqué » de son domaine. La rupture violente que Lacan a ainsi opérée tendait à « extraire » la psychanalyse du danger de son annexion par la psychiatrie et des institutions afférentes. Cette extraction revenait à la maintenir à distance de ces dangers non pas potentiels mais réels. Et c’est parce que Lacan a su pratiquer une telle mise à distance qu’il a préservé sa liberté, la sienne propre, mais aussi celle de l’analyse elle-même dès lors qu’elle n’était plus soumise à l’exigence éthique du bien qui est au ressort de l’exercice médical. J’espère que vous n’êtes pas lassé de m’entendre ressasser cette antienne de la nécessaire séparation de la psychanalyse avec le discours médical. Car si elle me paraît reconnues intellectuellement par beaucoup, elle n’entre pas dans les faits, il suffit de voir l’importance de la représentation du corps des médecins ou des psychologue au sein de leur groupe.
Deuxième leçon à retenir de l’hommage de Foucault. Comment Lacan s’y est-il pris dans son rôle de libérateur ? Réponse : en cherchant une théorie du sujet. Dans le texte de cet article si court et destiné à un grand public, on se surprend à lire une telle affirmation qui entre dans la complexité de l’apport de Lacan. Toutefois, avec une langue limpide, Foucault tient le propos suivant. Il s’associe aux jeunes lecteurs de Lévi-Strauss et de Lacan quand ils étaient étudiants :
Nous découvrions qu’il fallait chercher à libérer tout ce qui se cache derrière l’emploi apparemment simple du pronom « Je ». Le sujet : une chose complexe, fragile, dont il est difficile de parler, et sans laquelle nous ne pouvons pas parler (DE, II, 205).
En quoi consiste cette libération de ce qui « se cache derrière » l’emploi simple du pronom « Je » ? Il n’est pas besoin ici d’entrer dans le détail des développements de Lacan sur la division du sujet. Disons que la théorie du sujet telle que Foucault la trouve chez Lacan – cette expression de « théorie » demandant de notre part quelque réserve – introduit une complexité là où la médecine a tendance à ontologiser le sujet, pour en faire tel ou tel être affecté de telle ou telle pathologie. Ce ne sera pas cette « fragilité » du sujet qui nous retiendra ici, mais le rapport que le dit « Je » entretient avec le « Nous » dont nous avons commencé à parler la séance précédente, ce « Nous » particulier dont Fasula nous propose une analyse fournie dans son étude du texte de Foucault. Retenons, au-delà de la fragilité de ce sujet, la difficulté qui est la nôtre à en parler en même temps que la nécessité de la faire dès lors que ce « Je », nous ne cessons de l’employer. Revenons à cette idée de libérer tout se qui se cache derrière l’emploi du pronom « Je ». Cette expression utilisée par Foucault indique qu’il y a un recel de formes du « Je » qui empêche leur mise à jour. Et parmi celles-ci, se pose la question de ce qui peut ainsi les maintenir cachées, dissimulées, non libérées, comme si elles n’attendaient que cela, sortir du bois où, comme le lièvre, elles se cachaient. Allouch a dépisté l’une de ces formes dans ce qu’il appelle les « sujets sans « nous » », c’est-à-dire des formes du sujet non collectivisables, non intégrables au sein d’un commun qui les rendent identiques par exemple, par identification à l’image ou au trait d’un leader. En tirant sur ce fil, vient en effet l’impossibilité qui se déduit de cette approche du « Je » de pouvoir être enfermé dans une catégorie, que ce soit dans une classe nosologique psychiatrique ou dans toute autre forme de communauté humaine. Souvenons-nous de la séance de cet atelier, la deuxième, celle du 23 janvier dernier. Nous y parlions de ce qui a constitué le cercle magique, soit des ingrédients nécessaires à la constitution de ce cercle. Il y en a deux : 1/ la focalisation de l’attention sur un certaine scène ; 2/ la communauté se constitue alors que chacun reste parfaitement isolé. Hé bien, la rupture violence que Foucault attribue à Lacan avec la psychiatrie peut reposer sur cette façon dont se constitue le cercle magique avec ce double volet de l’attention portée à la scène lacanienne et de ce que chacun qui y entre reste parfaitement isolé.
Toujours dans le même texte, Foucault n’hésite pas à avancer un point de vue audacieux. Répondant à une question de Nobécourt sur l’hermétisme de Lacan voici sa réponse :
[Lacan] voulait que le lecteur se découvre lui-même comme sujet de désir, à travers cette lecture. Lacan voulait que l’obscurité de ses Écrits fût la complexité même du sujet, et que le travail nécessaire pour le comprendre fût un travail à réaliser sur soi-même.(204)
Rapportés à la constitution du cercle magique, nous trouvons les ingrédients indispensables dans ce passage de Foucault. Que la scène lacanienne suscite l’attention de celui qui y entre ne suffit pas. Encore faut-il que celui y entre y aille de lui-même. Qu’il en tire les conséquences, cela suppose de sa part un travail sur lui-même qui le fasse avancer sur la ou les questions dont il est porteur. Et ce travail n’est pas simplement un travail intellectuel. C’est un travail qui lui permet de « se découvrir comme sujet de désir », soit une tâche tout sauf neutre. Il n’y aura pas de quidam bienveillant qui viendra vous prendre la main pour vous mener sur le droit chemin de la bonne façon de penser. Il n’y a pas de X tel que sans lui, il n’y a pas de moyen de bien penser. À chacun de se débrouiller à cette tâche. Tel serait le précepte que Lacan nous aurait laissé. Cela est bien entendu de susciter la plus vive colère contre lui, et a ouvert la porte à ceux qui ont vu dans cet hermétisme une fantastique occasion de s’ériger en formateur, ou en divulgateur voire en propagandiste de ce qui ne pouvait manquer de devenir du lacanisme.
Que dit enfin Foucault, dans cet article ?
Lacan n’exerçait aucun pouvoir institutionnel. Ceux qui l’écoutaient voulaient précisément l’écouter. Il ne terrorisait que ceux qui avaient peur. L’influence que l’on exerce ne peut jamais être un pouvoir que l’on impose (DE II, 204).
On a souvent reproché à Freud d’avoir exercé un pouvoir occulte de son vivant, en particulier dans les moments de crise comme ce fut le cas avec Jung. En créant son comité des sept anneaux, il témoigna de deux choses. D’abord qu’il avait effectivement transmis le pouvoir de la dite association à Jung et ensuite qu’il lui a fallu créer ce comité occulte pour saper le pouvoir de Jung et l’empêcher de mettre a main sur l’IPA. S’il avait exercé un tel pouvoir occulte dès le départ, il n’aurait pas eu besoin de créer un tel comité. Foucault constate que Lacan n’a jamais exercé un tel pouvoir institutionnel. Autrement dit, qu’il n’a rien imposé.
J’en vois beaucoup qui ayant connu son époque apporteront plus qu’une nuance à un tel propos. Je me contenterai d’accorder crédit à Foucault d’avoir repéré l’essentiel : comme libérateur de l’analyse, Lacan a eu ceci de nouveau par rapport à l’enseignement qui nous vient de l’histoire, cette histoire qui nous enseigne que les libérateurs, comme le souligne Kant, que les libérés n’ont de cesse, une fois libres, de demander à leur libérateur de prendre la place de leur ancien tyran, Lacan a eu ceci de nouveau, pendant un temps, d’avoir su résister aux sollicitations constantes qui lui ont été faites dans son école et par ses élèves de s’installer aux commandes de son école. Je dirai qu’il a su y résister, comme Foucault le dit dans cette interview, en optant pour l’influence plutôt que pour l’imposition. Loin de chercher à se faire obéir, c’est en tournant le dos à ses élèves, comme lorsqu’il griffonnait au tableau, qu’il se tournait vers la Chose Freudienne, qu’il montra combien il misait sur l’influence plus que sur l’obéissance. C’est ainsi, que le terme de libérateur, dans le titre de l’article de Foucault convient. Ce n’est pas en entrant dans le rôle du médecin psychiatre du livre de Canudo que Lacan a pu opérer mais en adoptant la fonction et la place de Korowski, c’est-à- dire en tournant le dos aux libérés pour s’occuper du tenant lieu de Mme Fellerson, que le cercle magique de son école s’est constitué. Il faudra nuancer ce propos car se produisit, à moment donné chez lui, un tournant qui changea la donne. Ce sera au moment où Lacan passera, comme le souligne Allouch, de la position du séminariste à celle de l’enseignant.
–
Chasser la mort de la vie est intolérable, écrit Allouch (101). Ce chapitre de son livre est celui qui provoque, à ce que j’en ai pas entendre, les plus grandes réserves. Peut-être s’agit-il de celui où son dire est le lus impliqué, peut-être aussi, celui qui provoque le plus d’angoisse. Parce qu’on ne parle pas de la mort sans susciter un certain degré de terreur chez qui écoute. Cette partie pourtant résume une part considérable de la contribution d’Allouch à l’analyse. Et comme il n’est pas ici question de la reprendre dans le détail, je soulignerai tel ou tel point remarquable de ce chapitre.
Tout d’abord, le rappel que les libérés du livre de Canudo ne se soulèvent jamais qu’à partir du moment où le médecin tente de dissimuler la mort de Mlle de Chaivry. Chasser la mort de la vie est intolérable. Expurger la mort de la vie est le signe même de celui qui porte, qui aide, qui veut agir pour le bien d’autrui, qui cherche à le ménager, sans même comprendre à quel point la mort est indispensable à cet autrui ne serait-ce que pour vivre.
Le second point porte sur ceci : il n’y a pas de mort véritable tant que n’est pas survenue la seconde mort. Que dire de ceci ? Que la mort simple d’une personne ne suffit pas à l’empêcher de continuer d’exister. « Il est une vie après la vie de la personne disparue. » L’être de cette personne subsiste (109), que ce soit à titre de fantôme (les fameux personnages qui hantent le livre Noir parfait de Valentin Retz), ou encore dans les cauchemars (ils y reviennent comme si la mort première, leur première mort, n’avait pas suffi à les faire disparaître. Allouch se contente d’une remarque simple tant elle paraît évidente à ce propos : aurait-on, ne serai-ce qu’effleuré l’idée du deuil, si la première mort nous avait définitivement séparé de l’être perdu ? Le fait même de parler de deuil ne nous indique-t-il pas que la mort , pour devenir effective, en nécessite une seconde qui plie l’affaire, c’est-à-dire fasse basculer dans l’oubli de l’oubli, sans laisser la moindre trace, la disparition de l’être aimé.
De ceci, se déduit que la mort véritable s’effectue comme effet véritable du passage de la première à la seconde mort. Que la mort est sèche, c’est-à-dire qu’elle est sans recours. Il n’y a pas, comme le laisse penser l’hypothèse du travail de deuil, de remplacement possible de l’objet perdu. Et qu’à aucun moment, on puisse imaginer un travail de compensation possible qui viendrait amortir le choc de la mort sèche. Allouch :
Jamais aucun « objet » malencontreusement dit substitutif ne viendra prendre la place de l’être désormais perdu et, moins encore, à procurer à l’endeuillé plus de jouissance encore que cet objet perdu. (110)
L’idée même de la substitution possible d’un être par un autre suppose que ne s’effectue pas la perte sèche, elle rendue possible par la seconde mort. La seconde mort fait que la substitution de l’être perdu ne se pose plus. Elle n’est plus à l’ordre du jour du survivant. Tout au plus, si comme question, elle se pose, s’en trouve-t-elle déclassée.
Allouch :
Seul un acte peut en quelque sorte signifier au mort que l’endeuillé le laisse se diriger vers ce qui sera, quoi qu’il en soit, son destin, à savoir sa seconde mort, et corrélativement, le laisser, li, l’endeuillé, en paix. Ce point où le mort s’en va vers la seconde mort est aussi celui où la perte de l’endeuillé advient comme perte sèche(111).
De quel acte s’agit-il ? Quel peut bien être l’acte qui « signifie au mort » que l’endeuillé « le laisse se diriger vers sa seconde mort ? On saisit que cet acte réside dans la fait que l’endeuillé donne son congé au mort, ne le retient plus, le laisse tomber. Ainsi cette réaction d’un enfant devant la dépouille de son père et qui, saisi par le côté carton de la peau inerte, s’est écrié : « Il n’ya plus qu’à jeter ça, maintenant. »
Cet acte ne peut par conséquent qu’être un acte de liberté par lequel l’endeuillé s’adresse à la liberté du défunt de ne plus rester et de s’en aller vers sa seconde mort qui le délivrera, l’endeuillé de la hantise du mort, et le mort de la rude tâche de ladite hantise. Ainsi donner congé au mort pour le laisser libre de s’engager sur la voie de son destin, soit celle de sa seconde mort. Telle est la condition de l’accès de l’endeuillé à la paix, à une paix débarrassée de cette occupation intempestive qui lui fait rencontrer le mort à tout bout de champ, à tout coin de rue, jusque dans l’image que telle ou telle lui offre qui serait une évasion possible de sa hantise.
C’est seulement quand se sera réalisé la seconde mort du défunt qu’apparaîtra cette mort, pour l’endeuillé, comme ce qu’elle est : une perte sèche. Perte sèche, je le rappelle indique que la perte est sans mémoire, sans souvenir, sans trace, ainsi qu’Alexandre traversant une plaine de la Perse sans savoir que son cheval foulait du pied le site de Ninive (à vérifier).
–
Des voyages de Rimbaud, on dit que la troisième, celui qui devait le mener à Paris rejoindre la Commune insurgée est sujet à caution. Inutile d’entrer dans la controverse d’experts. Tout au plus rappelle-t-on ce Chant de guerre parisien, dont voici un extrait :
La Grande ville a le pavé chaud,
Malgré vos douches de pétrole,
Et décidément, il nous faut
Vous secouer dans votre rôle..
Ou encore, ce passage de Les mains de Jeanne-Marie (256) :
Elles ont pâli, merveilleuses,
Au grand soleil d’amour chargé
Sur le bronze des mitrailleuses
À travers Paris insurgé !
Ah ! quelquefois, ô Mains sacrées,
À vos poings,
Mains où tremblent nos
Lèvres jamais désenivrées
Crie une chaîne aux clairs anneaux
Et c’est un soubresaut étrange
Dans nos êtres, quand, quelque fois,
On veut vous déhâler,
Mains d’ange,
En vous faisant saigner les doigts !
Rimbaud nous propose ici une nouvelle définition du soulèvement. Il s’agit d’un soubresaut étrange, celui que l’on ressent lorsque l’on tente par la contrainte de vous déhaler, de vous déplacer comme lorsque l’on tire un bateau mobilisé passivement par les chevaux qui le tractent sur les chemins de halage. Nulle jouissance dans ces doigts qui saignent, ce serait aller trop vite, car le soubresaut étrange n’est autre chose qu’un acte, qu’un acte comme passage, ici le cri d’une chaîne aux clairs anneaux.
On ignore que la Commune de Paris n’a pas seulement inspiré des vers à Rimbaud. Delahaye reçut dans le courant du mois d’août 1871, un Projet de constitution communiste, rédigé d’une plume serrée sur un cahier d’écolier par Rimbaud. On a malheureusement perdu le texte. Delahaye en parle dans ses souvenirs :
Le peuple s’administre sans intermédiaire, en se réunissant tout simplement par commune ou par fraction de commune, pour voter les décisions utiles au groupe. Tout exercice indispensable d’autorité, toute direction du travail dépendent du vote, et la mission ainsi conférée doit être, au bout d’une courte période, renouvelée de la même manière.
Comme cette république idéale est communiste, fondée sur la suppression de l’argent et l’organisation de l’unique travail nécessaire à la vie, son fonctionnement n’a pas besoin d’autres complications.
Surprenant texte venu de la plume du poète. Delahaye ajoute qu’il y avait dans ce texte la socialisation des biens fonciers, des moyens de production, une législation directe, venue des citoyens égaux, au sein des communes indépendants mais fédérées.
Le soulèvement de Rimbaud n’est pas seulement un soulèvement par et pour la poésie qui inaugure un nouvel ordre littéraire, si tant est que l’on puisse avancer que tel a été son souci. On y voit que celui-ci pouvait prendre plusieurs formes. Celui-là qui écrivait :
Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées ;
Mon paletot aussi devenait idéal ;
J’allais sous le ciel, Muse ! et j’étais ton féal ;
Oh ! là ! là ! que d’amours splendides j’ai rêvées !
Rimbaud dans son soulèvement ne s’est pas contenté de porter un paletot idéal. Ce qui aurait pu prêter à rire. Plus sérieusement, son soulèvement lui fit prendre le temps d’assortir à la poésie un projet constitutionnel communiste dont, malheureusement aujourd’hui, on ne parle plus, pour ne nous laisser de lui, que cette image d’un jeune homme marcheur sur les routes de France, allant sous le ciel, « les poings dans les poches crevées. » Ce n’est pas, à nos yeux, le contenu de ce projet qui importe et qui réunit les idées socialistes de son temps, que l’acte lui-même qui l’amena à utiliser le temps libre dont il disposait à Charleville, pour rédiger un tel projet.
En 1935, dans l’école de préservation pour les jeunes filles de Clermont de l’Oise, éclate une révolte. Déjà, l’année d’avant, en 1934, un article paru dans L’Œuvre, le journal radical socialiste local, avait décrit les premières manifestations d’une mutinerie : « Obsédées par un régime déprimant, les détenues de Clermont ont essayé, il y a quelques jours, de se révolter en masse. Elles ont brisé les portes de leur cellule, délivré celles qui étaient au cachot, molesté leurs garde-chiourme femelles, tandis que des hymnes révolutionnaires s’élevaient de tous les coins de la colonie. Pendant trois heures, les détenues sont restées maîtresses de la maison de Clermont, sans réussir toutefois à s’évader et il a fallu l’intervention de la force publique pour les maîtriser. »
L’article du journal n’est guère tendre avec les responsables de l’établissement qualifié de « bagne d’enfant », de « colonie pénitentiaire » où règne la politique des circulaires et de l’escroquerie morale ».
Dans un rapport du directeur de l’établissement pénitentiaire au Préfet du département on lit : « J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’un commencement de mutinerie, qui n’a pu être enrayé que par des mesures énergiques, s’est produit hier 1er juillet, au quartier correctionnel de l’établissement.» Depuis plusieurs jours, il avait remarqué des protestations des « pupilles » au sujet de la nourriture, une baisse du rendement au travail et du désordre le soir au dortoir. La tension s’accroît dans l’établissement au point. Lors d’un atelier, deux d’entre elles déclarent qu’on leur en avait assez fait voir et que maintenant c’était à leur tour. Le soir venu, elles se mirent à crier dans leur dortoir, à siffler et à chanter. Puis elles se mirent à taper de toute force à la porte de leur chambrette, espérant susciter l’extension de leur mouvement par leur tapage. La répression ne se fit pas attendre. Elle vint facilement à bout de la mutinerie. Le directeur pris des mesures punitives énergiques contre les plus coupables d’entre elles, en les incarcérant en cellules pour des durées pouvant aller jusqu’à 60 jours.
À propos de la première révolte de Clermont, on trouve, dans Vagabondes, cette lettre du Sous-Préfet de Compiègne, que je vous donne à lire, car elle témoigne du vocabulaire de l’époque :
Voilà. Ce qui pose problème dans ce courrier, est que le titre de maison de préservation des jeunes filles ne trouve plus sa justification dès lors que, dans cette même maison, alors qu’elles pourraient être « relevées », les filles se corrompent bien au contraire, immanquablement. Sous la plume de ce sous-préfet, ce n’est pas l’opposition entre relèvement et chute qui importe mais celle entre relèvement qui laisse la place à la corruption.
Sophie Mendelsohn, dans un article publié en fin de livre, cite en exergue le passage suivant :
Ce qu’il y a de plus difficile dans le relèvement des enfants, c’est le relèvement des filles. Ce qu’il y a de plus difficile dans le relèvement des filles, c’est le relèvement de celles qui sont tombées jusqu’à la prostitution publique.
Cet extrait, tiré d’un rapport d’inspection datant du début du XXe siècle, rédigé par un directeur d’école de préservation pour les jeunes filles, nous retient par le choix du vocabulaire employé. On y trouve une vision de l’éducation des filles toute particulière puisque l’on y lit qu’éduquer, c’est relever. Relever des enfants, relever des filles, telle est la tâche allouée aux directeurs de ces établissements. Sandra Alvarez de Toledo, remarque que l’idéologie qui prévaut dans ce genre d’établissement est celle du relèvement des filles par une éducation paternaliste fondée sur la morale de l’hygiène et du travail1. Le recours au relèvement des filles, nous dit tel directeur, est d’autant plus difficile qu’il concerne des filles qui sont tombées (je souligne) dans la prostitution. Il y a donc un double mouvement qui, tous deux, sollicitent la verticalité : la chute (« elles tombent dans la prostitution »), le relèvement
1 Vagabondes, « Note de l’éditrice », L’Arachnéen, Paris, 2015.
(« on les relève, on les sort de la fange, on les redresse, on leur apprend à marcher la tête haute. ») Ces deux mouvements de chute et de relèvement peuvent paraître antinomiques. Ils le sont en effet, ils sont dans leur emploi une connotation morale qui évoque la fantasme bien connu : « on sauve un enfant ». On l’énoncerait ainsi : « on sauve un enfant en le relevant. » En fait, ils ne sont pas antinomiques sur un point : que ce soit dans la chute ou dans le relèvement, les enfants suivent passivement le mouvement. Et cette passivité ne fait que souligner à quel point, quand les filles tombent dans la prostitution, ou quand on les relève, elles suivent le mouvement, elles sont portées par les événements, comme le ferait un pédophore qui, soit laisse tomber l’enfant, soit le relève quand il est tombé ou s’amuse à le lancer en l’air.
Eh bien, une telle passivité ne se retrouve pas avec le soulèvement. Le soulèvement suppose le passage à l’acte du sujet qui le produit. Se soulever, c’est évidemment cesser de tomber, mais c’est aussi, cesser de se faire relever. On se soulève tout seul. Tel est le point. Et partant de ce constat, il va devenir possible de lire le chapitre III du livre d’Allouch, « Laisser tomber les enfants. »
Quand, au début du chapitre, Allouch rend hommage à tous ceux qui ont laissé tomber leurs enfants, il donne d’emblée ses raisons. En agissant de la sorte, ils ont fait place nette à la liberté de l’enfant (122). Allouch passe en revue une série d’exemples que je ne vais pas reprendre ici, mais je voudrais pour poursuivre dans la direction donnée à ce propos, m’arrêter un peu plus précisément sur la « Verticalité. » C’est justement dans le paragraphe consacré à ladite Verticalité qu’Allouch se réfère à Vagabondes.
Que font les jeunes filles prises dans ces maisons de correction ? Il leur arrive de se soulever. Soudain, elles se mettent à chanter, danser, crier, à casser la vaisselle, à faire preuve d’indiscipline. Elles en arrivent jusqu’à chanter des hymnes révolutionnaires. Bref, à certains moments, elles vivent. Le cachot, l’enfermement, le transfert dans d’autres maisons, les punitions, tout cela les attend. Elles le savent. Néanmoins, elles persistent. La correction vaut pour rappel à l’ordre des autorités contre les fortes têtes qui se manifestent. Mais quoi, quel avenir se dresse devant elles ? Un travail à l’usine, ou dans les champs, ou bien encore comme domestique dans une famille bourgeoise où il faudra subir les avanies de la maîtresse de maison et les avances appuyées de son époux ? Puis, il écrit :
On élève un enfant ; « élève », c’est même en le désignant ainsi qu’il est inscrit à l’école sans, en cela, avoir été le moins du monde consulté. Un enfant, cela tombe.(129)
On est ici frappé par le redoublement des termes qui portent sur la verticalité : relever, élever, élève, soulever, puis tomber, chuter. Dans la domaine de l’éducation prévalent toute une série de termes qui nous renvoient à la verticalité, quelque ce soir au demeurant le sens du mouvement. Dans cette phrase qui vient d’être citée, on gagnerait à la substantification des verbes. Et l’on verrait le spectre des possibles s’élargir : élevage, élèvement, élévation, élèves, puis soulèvement, sublevation, nous mettant devant un champ à exploiter des plus divers. Revenons à cette affirmation : un enfant, cela tombe. Cela indique que, pour peu que l’on refuse de le porter, de le dresser, de l’élever, cela tombe, comme tout objet qui, laissé à lui- même, se laisse dominer par les lois de la gravitation. Quand Allouch dit que « cela » tombe, ce « cela » indique que, comme tout objet, il a un poids, et que la vie ne va pas cesser de lui offrir des occasions de tomber, comme, lors de l’accouchement, il sera expulsé du ventre de sa mère, ou plus tard, lors que, malencontreusement, il tombera des bras qui le portent, avant qu’arrivé à un âge plus avancé, il ne tombe amoureux, sans exclure qu’au cours de sa vie, il ne tombe dans une ornière, pour enfin aboutir, à la fin de sa vie, dans sa tombe. Il est incroyable de constater combien, après avoir été tellement élevé, dressé, relevé, nous, autant que nous sommes, ne cessons de tomber dans notre vie.
Ce constat ne fait que nous montrer l’importance de la verticalité à laquelle il est bien difficile d’échapper. Sans compter pour l’homme, les termes d’homo erectus, ou d’érection lorsqu’il se trouve surpris par une réaction incongrue de son corps. La femme « tombera enceinte », ou les deux, surtout en cette saison, « tomberont malades.»
Laisser tomber, un enfant, cela revient à faire place nette pour sa propre liberté. Soit le laisser se débrouiller sans tenter de lui apporter de l’aide lorsqu’il se trouve pris dans la difficulté. « Qu’il se débrouille », voilà qui en une phrase, résume la position que l’on tient lorsqu’on le laisse tomber. On se rappelle le commentaire de Freud, dans l’Esquisse d’une psychologique scientifique, sur la détresse, Hilfloszigkeit, dans laquelle l’enfant se trouve pris, lorsque, livré à lui-même, il est sans secours, en détresse. Allouch cite la séance du 29 juin 1960 du séminaire L’Éthique de la psychanalyse, où Lacan commente ainsi ce passage :
Ici, comme je crois vous l’avoir montré dans la région que j’ai pour vous cette année dessinée, cette fonction du désir doit rester dans un rapport fondamental avec la mort. Je pose la question de savoir, la terminaison de l’analyse, la véritable, j’entends celle qui prépare à devenir analyste, ne soit pas, à son terme, affronter celui qui la subit à la réalité de la condition humaine qui est proprement ceci que Freud, parlant de l’angoisse, a désigné comme étant le fond où se produit son signal, à savoir cette Hilflosigkeit, cette détresse, qui s’articule proprement en allemand dans ce terme en ceci que l’homme, à ce niveau, dans ce rapport à lui-même qui est sa propre mort – mais entendons, au sens que je vous ai appris à la dédoubler cette année – n’a à attendre d’aide de personne, c’est-à-dire, doit finalement atteindre, et connaître – j’entends au terme de cette analyse didactique-le champ, le niveau de l’expérience de ce désarroi absolu, de ce désarroi au-delà de celui au niveau duquel l’angoisse est déjà une protection[…].
Cette citation fort peu connue de Lacan se trouve d’une acuité toute particuière. J’en reprends pour en souligner la force la passage le plus éclairant : « L’homme, à ce niveau, dans ce rapport à lui-même qui est sa propre mort – mais entendons, au sens que je vous ai appris à la dédoubler cette année – n’a à attendre d’aide de personne, c’est-à-dire, doit finalement atteindre, et connaître – j’entends au terme de cette analyse didactique-le champ, le niveau de l’expérience de ce désarroi absolu.» Être hilflos, c’est être sans aide, mais pas seulement. Car se retrouver ainsi peut plonger dans l’attente et la détresse, ce qui est bien souvent le cas des personnes qui viennent nous voir en analyse. N’est-il pas fréquent de les entendre dire qu’elles viennent nous parler car elles en ont besoin, et que les écouter les aide. Eh bien, non, l’homme n’a attendre d’aide de personne, surtout quand il est pris dans sa condition véritable, celle qui le met en rapport avec sa propre mort. Lacan poursuit, qu’en ce qui concerne l’analyse, la fameuse analyse didactique, ellle est l’expérience qui lui fait atteindre et connaître le champ de l’expérience de ce désarroi absolu. C’est un désarroi sans l’aide de personne, c’est le désarroi que l’on connaît quand on n’attend plus une telle aide, un tel recourrs, un tel secours, quad on se débrouille tout seul sans demander son reste.
Que signifie alors, « laisser tomber les enfants » ? Cela revient à ne pas offrir de l’aide quand il connaît ce moment de détresse. Soit considérer qu’une telle aide, si elle était donnée, serait malvenue, et que ce n’est pas ainsi que l’on va s’y prendre en s’adressant à la liberté de l’enfant. Allouch résume cette ananlyse d’une phrase : « Vivre autrement dit se séparer, c’est chuter (135). » Nous voici arrivés dotés d’une nouvelle approche de la liberté : la liberté, c’est l’expérience du désarroi absolu dès lors que l’on n’attend plus rien de personne.
Aussi l’analyse se déploie-t-elle dans un autre registre que celui de la verticalité quand elle a lieu. Le soulèvement qu’elle peut occasionner sollicite ladite verticalité, mais celle-ce n’advient qu’à partir d’une horizontalité franche et déclarée. Se coucher, s’allonger n’a que peu à faire avec le fait de dresser quelqu’un, de l’éléver, de le domestiquer. La spatialité entre dans l’affaire. Elle est loin d’être neutre.
Quelle expectative reste-t-il à l’enfant porté dans les bras des adultes ? Tout pris qu’il est dans la verticalité, la seule solution pour y échapper est de se soulever. Le soulèvement répond à celui qui veut l’élever, à le relever, voire le dresser. Car c’est ainsi qu’il peut arriver à s’en séparer. L’exemple n’est pas rare du nourrisson qui refuse le sein, au plus grand désespoir de sa mère. Imaginez la scène où celle-ci s’isole dans la chambre, tire les rideaux et dans l‘obscurité ainsi trouvée, allaite l’enfant qui daigne enfin accepter le sein. Quelle plus belle marque du soulèvement que celui de ce nourrisson !
Dès lors se pose la question des parents lorsque leur enfant refuse d’aller à l’école. Comment se comporter vis-à-vis de lui ? Faut-il lui imposer d’aller à l’école, pour son bien, comme on l’avance souvent ? Ou bien accepter qu’il n’y aille pas, en le laissant prendre le risque des conséquences qui seront produites par son acte ? N’est-ce pas ainsi qu’il conviendrait de le laisser libre de son choix, quitte à ce qu’il prenne en même temps le risque des conséquences que son choix suppose ? Encourir ce risque ne doit pas relever de la crainte de représailles. Que l’enfant tombe, répond pour lui à la nécessité vitale où il se trouve d’endosser à son risque, la liberté qu’il réclame et dans laquelle, par son acte, il s’engage. Dans ce chapitre d’Allouch, les exemples abondent tant ils sont fertiles dans la littérature. Je ne ferai de mon côté que donner ici un exemple, celui d’une jeune prostituée roumaine qui venait pour soin et qu iprésentatit une impressionante déperdition de substance dans la cuisse droite. Elle refusait, malgré les efforts déployés par tout son entourage, de cesser de s’injecter de l’héroïne dans la plaie béante. Elle se dégradait de plus en plus jsqu’à ce que soit prise la décision de ne plus s’occuper d’elle, de ne plus la porter très directement, de la laisser tomber. Quelques semaines plus tard, elle alla à l’hôpital pour se faire soigner. La leçon que j’ai tirée de cette expérience, est qu’elle refusait de se faire prendre en charge, qu’il avait fallu la laisser tomber pour que d’elle-même, elle s’engage dans ses soins, avec succès d’ailleurs. Autrement dit, ce fut lorsqu’elle se retrouva livrée à elle-même qu’elle put éprouver sa chute, celle-là qui ne pouvait que la conduire à la mort, en raison du risque infecteux qu’elle prenait. Loin de réagir sous l’emprise d’un sursaut salvateur, ce fut bien plutôt parce qu’elle chutait dans la tombe, qu’elle prit vie et s’engagea dans l’expérience de la liberté qui consistait, pour elle, à décider de sa vie. Nul ne peut mesurer l’importance vitale pour tel ou tel d’être laissé tomber, car c’est parce l’on s’est adressé ainsi à sa liberté, qu’il s’est retrouvé vivant et libre.
Nous nous retrouverons la prochaine fois le 28 mars, pour lire le chapitre portant sur la politique lacanienne.
–
George-Henri Melenotte