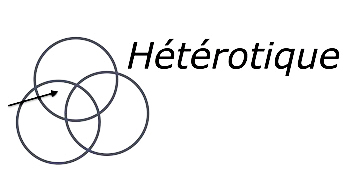Atelier deux analytiques du sexe
Quatrième séance – 21 février 2018 Strasbourg
–
Ce qui est entre la pomme et l’assiette se peint aussi (Braque).
Il m’est parvenu à l’oreille que Freud incognito décidément se préoccupait trop d’un mémorial et qu’il y avait bien d’autres lieux dignes d’intérêt. J’en ai conclu que les porteurs de ces amabilités de pouvaient pas entendre que la constitution du cercle magique trouvait son point de départ dans la mort. Et que vouloir le dissocier du reste engageait dans une impasse sans retour.
Nous avons vu dans la séance précédente de l’atelier la façon dont se constituait une collectivité sans hiérarchie, sur la base de la scène lacanienne, selon Allouch, et du cercle magique qui se constitue autour d’elle.
Cette façon, Allouch la propose dans son diagramme 3, où Lacan tient la scène avec la Chose pour partie freudienne en même temps que se constitue autour de lui le cercle magique de ses élèves. Lacan y trouve là ce qui l’a amené à rejeter la fossilisation ipéiste pour laisser la place à son école.
Lacan a-t-il réussi dans son entreprise ? On ne saurait en être sûr. Allouch remarque, à juste titre à mon avis, que bien des analystes, et non des moindres, se maintiennent soigneusement à distance de toute école qui s’inspire du modèle que lui-même a inventé. Il y a donc là quelque chose qui n’a pas fonctionné et qui nous mène au constat que l’école dite de Lacan n’a pas réussi dans son entièreté. Au sein de l’école lacanienne de psychanalyse, on trouve des groupes organisés selon un modèle proche de l’IPA, même s’ils s’en différencient heureusement sur des points importants. Allouch cite un ouvrage récent de Pierre Fasula, (« Moi et les autres : une critique wittgensteinienne de Foucault », dans Pascale Gillot et Danièle Lorenzini (sous la dir. de), Foucault/Wittgenstein. Subjectivité, politique, éthique, Paris, CNRS Éditions, 2016, p. 197-212.) qu’il faudrait que l’un d’entre nous lise de façon à nous le présenter pour une prochaine fois. Il s’y livre à une lecture critique de ce qu’il intitule « Le Je et le Nous », terrain difficile et propice à notre réflexion actuelle. Il y est posé, que, comme Les Libérés de Canudo, comme Lacan avec l’IPA, Foucault, penseur de la gouvernementalité, s’est attaqué à la question du rapport entre le Je et le Nous (93).
Dans le texte « La philosophie analytique et la politique » (Dits et Écrits, t. II, p. 535, cité par Fasula, p. 209), on lit ceci (cité par Allouch, p. 94) :
Parce que, après tout, si la question du pouvoir se pose, ce n’est pas du tout parce que nous l’avons posée. Elle est posée, elle nous a été posée. Elle nous a été posée par notre actualité.
Allouch commente cette phrase. L’accent doit ici être mis sur le « nous » du « nous a été posée. » De quoi s’agit-il avec ce « nous » ? Réponse d’Allouch : il s’agit d’une « inclusion, voire d’une imposition » (94). Il convient par conséquent de se pencher sur ce « nous » pour voir de quoi il est formé. Le « nous » est un piège. Il est constitué par le « je » qui n’est que mise au singulier du « nous ». Mais le « nous » n’est pas seulement la mise au pluriel du «je». Il est «quelque chose de plus que la mise au pluriel du «je». Le «je» doit être distingué. Foucault instaure une distinction entre l’intellectuel universel – pense-t-il à Sartre ? – et l’intellectuel spécifique. Si l’intellectuel universel parle « au nom des autres », représente ainsi les autres, l’intellectuel spécifique se positionne autrement. Ce qui importe à l’intellectuel spécifique est son renoncement à être « une instance représentative » (94). Chez l’intellectuel spécifique, son raisonnement est lui aussi spécifique. Fasula écrit qu’il n’est plus « en communauté avec personne. »Il n’a plus la possibilité de dire « nous. »
Quel est l’effet produit par l’intellectuel spécifique ? Allouch :
Il arrive que la scène sur laquelle il joue sa partie en questionnant on ne sait trop quoi intéresse d’autres que lui, les intéresse au point que se forme autour de cette scène un cercle magique
(94).
Ainsi, poursuit Allouch, Freud, Korowski, Lacan, Foucault, et bien d’autres « de diverses façons, sont des sujets sans « nous », seuls, certes, mais non point isolés. » Est-ce dire que ceux qui viennent d’être cités puissent être rassemblés à leur tour dans une communauté ? Certes pas, poursuit Allouch, puisque Korowski et Foucault ne pouvaient être trahis, alors que tel ne fut pas le cas de Freud ou de Lacan.
Allouch analyse la position de Lacan. Par sa position, Lacan s’est exposé au risque d’être trahi. Il fournit les points, à ses yeux déterminants, qui ont contribué à la mise en place de sa nouvelle position. Les voici (95) :
1/ Le passage de son séminaire de l’hôpital psychiatrique (Ste Anne) à l’École Normale supérieure (ENS), avec son élection par des jeunes «princes de l’Université ».
2/ La fondation de l’École freudienne dont il assurera la direction jusqu’à la fin.
3/ La parution des Écrits qui va entériner le changement de public.
Le changement ainsi produit par Lacan a eu un effet sur ce que l’on avait considéré jusque-là comme étant son « enseignement (96). Allouch distingue le Lacan séminariste du Lacan enseignant :
Un séminariste ne peut être trahi ; un enseignant, tout au moins un certain type d’enseignant, le peut. Un séminariste présente et étudie un problème, demande à son public qu’il lui fasse part de ses avis, qu’il contribue à sa recherche, qu’il la critique aussi loin qu’il le souhaite, mais ne demande pas une adhésion. La demande d’adhésion est devenue ouverte lorsque la chose freudienne (que Lacan questionnait) est advenue cause, cause freudienne dit-on.
Dans un ouvrage récent, Moustafa Safouan, souligne qu’on ne peut être psychanalyste et militant. Selon lui, Lacan a été « victime de ce dont il avait fait une cause. ». Allouch : « Il y a un abîme entre introduire un nouveau paradigme dans un certain champ, freudien en l’occurrence, ce à quoi Lacan s’est employé avec son S.I.R., et défendre une cause. Le virage de S.I.R. à « hérésie » scelle le passage de Lacan séminariste à Lacan enseignant (97). » Allouch tempère : on peut certes conserver le qualificatif d’enseignant à Lacan quand il donne à ses élèves le goût de la discipline qu’il transmet, comme le fait Korowski peignant le portrait de Mme Fellerson. Mais « l’effet d’entre » ne joue plus lorsque l’enseignant oriente son enseignement non plus sur ce qu’il fait mais sur ses élèves (98). Lacan, dans ses fameuses présentations de malades, ne visait pas tant à enseigner ses élèves que de parler avec quelqu’un, ce qui produisait ledit effet.
Allouch conclut ainsi ce chapitre :
On n’accordera à Jacques Lacan sa juste place dans le champ freudien qu’en prenant acte (en le prolongeant) de ce qui spécifie son intervention dans ce champ : ce qu’il dénommait son « enseignement » (encourant le risque de mille malentendus et dérapages) ne relevait ni du discours universitaire, ni du discours du maître (99).
Voilà, si ce n’était la lourde équivoque que pourrait porter mon propos et le caractère déplacé de l’impératif, je vous proposerais cette formule un peu brève : « Soyons tous séminaristes !»
–
Je voudrais maintenant prendre le temps de revenir sur l’entre, à partir de lectures que j’ai faites et que je m’en vais maintenant vous présenter.
Dans Repousser les frontières ?, livre paru en octobre 2014, Barbara Cassin s’interroge avec d’autres philosophes, écrivains, philologues et neurobiologistes sur la notion de frontière. Elle le fait à partir d’une expérience dramatique qui a transformé la mer Méditerranée en cimetière humain. Le 3 octobre 2013, quatre cents réfugiés sont morts au large de l’île de Lampedusa. La liste des noyés depuis s’allonge, dans une presque totale indifférence des européens devant la tragédie. La Méditerranée n’est plus la mer qui faisait le lien entre l’Afrique et l’Europe, elle n’est plus le bassin qui a servi de berceau à notre civilisation, le lieu où le commerce a prospéré dès l’Antiquité, lieu des échanges commerciaux mais aussi culturels et civilisationnels, lieu de guerres aussi. Ce vaste espace intermédiaire a vu se dérouler non seulement l’histoire millénaire des peuples qui ont vécu sur ces rives mais a été un creuset de langues d’où vinrent les premières écritures. Voici que cet espace entre les langues, les peuples et les cultures est devenu le lieu où périssent par dizaine de milliers les réfugiés qui fuient la mort et la misère dans leurs pays.
Qu’est-ce qu’une frontière ? s’interroge Barbara Cassin. C’est une ligne de partage, une ligne de partage de souveraineté qui, pour fonctionner, doit être reconnue par ceux qui vivent de part et d’autre. Elle est aussi un lieu de passage qui permet de mettre en contact des différences, voire des contraires, pour les mettre en contact, les unir. Quand la frontière se présente sous la forme de la limite entre deux espaces distincts, elle devient une frontière-mur que garde une armée contre l’ennemi. Alors qu’elle permettait de donner hospitalité à l’étranger qui la franchissait, elle devient la raison de la désignation de l’ennemi. L’ennemi est celui qui la menace.
Que se passe-t-il à Lampedusa ? Avec les noyés de Lampedusa, dit Cassin, c’est une autre frontière qui est en train de surgir, celle où les hommes qui s’y trouvent sont réduits à ne plus être reconnus comme hommes. Le Traité de droit maritime général fait obligation de secours aux personnes et de sauvetage aux navires, et l’article 11 de ce Traité stipule, que « tout capitaine est tenu, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée à la mer, en danger de se perdre. » Sauf que les lois nationales en Europe dénoncent les activités visant à aider l’immigration clandestine et les punissent. Ainsi, le 1er septembre 207, sept pêcheurs tunisiens, dont leur capitaine, ont été arrêtés alors qu’ils avaient recueilli et sauvé quarante trois personnes naufragées. Le motif de leur inculpation était qu’ils s’étaient conduits en passeurs. Le droit national sur les migrations prime sur le droit international. Aussi le migrant qui se noie ne doit-il pas être secouru. Problème : ce non recours à l’aide à apporter à une personne en danger n’expose-il pas à la sanction de la loi qui pénalise celui qui ne lui porte pas aide et assistance ? Seule issue possible de ce dilemme : ne pas considérer le migrant comme une personne. Je cite ici Barbara Cassin : « On laisse donc qui se noyer ? Je ne dis pas « qui ». On laisse quoi se noyer ? Quelque chose comme un non-homme, un pas tout à fait homme – le produit de ce type de frontières sécuritaires. » (Repousser les frontières ?, sous la direction de Jean Birnbaum, Paris, folio, essais, octobre 2014, p. 22). Voilà, la distinction est posée, celle-là même qui existe chez Aristote entre le grec et le barbare. Si le grec trouve dans sa langue le support à une identité, s’il fait de sa langue un outil identitaire, tel n’est pas le cas du barbare. Barbara Cassin : « Qu’est-ce qu’un barbare ? Bla-bla-bla, balbus (bègue), Babel, babil. » Bla-bla-bla, c’est « une onomatopée pour désigner la confusion d’une langue que l’on ne comprend pas. Un barbare, poursuit-elle, est quelqu’un dont on n’est pas vraiment sûr qu’il parle. » (24) Et, « puisque la définition de l’homme, c’est d’être un animal, un vivant « doué de logos », est-ce vraiment un homme ? ». Nous nous retrouvons avec la même problématique que celle du migrant.
Dans Éloge de la traduction, compliquer l’universel, Barbara Cassin reprend cette distinction en la précisant. En Grèce, s’opposent deux catégories pour définir la frontière : celle géographique qui délimite un territoire, celle définitionnelle qui qualifie l’humain. Cette dernière distinguera le barbare de l’hellène ou l’esclave de l’homme libre. Dans Politique (III, 1285 a 20), Aristote cite ainsi les poètes : « « Au barbare, l’Hellène a le droit de commander « , comme si par nature, poursuit-il, barbare et esclave, c’était la même chose. » Cette distinction montre l’universalité pathologique du logos, puisque Aristote donne au grec la statut de la langue universelle en dehors de laquelle il n’y a que confusion, tout juste digne du barbare ou de l’esclave. Or, souligne Cassin, nous ne parlons jamais qu’une « langue entre autres ». Elle cite alors Lacan dans L’Étourdit :
Le dire de l’analyse ne procède que du fait que l’inconscient d’être structuré comme un langage, c’est-à-dire lalangue qui l’habite, est assujetti à l’équivoque dont chacune se distingue. Une langue entre autres n’est rien d’autre que l’intégrale des équivoques que son histoire y a laissé persister. (L’Étourdit, Scilicet 4, Paris, Seuil, 1973, p. 47)
Contre Aristote, Cassin avance, comme Lacan, qu’il n’y a jamais qu’une langue entre autres. Cela disqualifie toute langue d’avoir une prétention identitaire et ouvre un espace particulier, où l’univocité du sens ne domine pas, mais où la question du sens se pose par le biais de la traduction. Car, dans l’espace entre les langues, règne sans partage la traduction. La traduction y est présentée comme nouveau paradigme des sciences humaines (222) Elle crée « le passage entre les langues, entre. » (220)
François Jullien se montre très proche du propos de Barbara Cassin. Dans L’écart et l‘entre, Leçon inaugurale de la Chaire sur l’altérité, on trouve le passage suivant :
Qu’est-ce, en effet, que traduire si ce n’est ouvrir-produire de l’« entre » entre les langues, de départ et d’arrivée. (63)
Il ajoute que le propre du traducteur est de se maintenir aussi longtemps qu’il pourra sur la brèche de l’entre deux langues. Le parcours de François Jullien éclaire le nôtre pour plusieurs raisons. Il inscrit l’« entre » dans une progression qui le fait partir de la différence, pour ensuite passer par l’écart, l’ « entre » et enfin l’altérité.
Ce qui nous intéresse dans le propos de Jullien peut se repérer à chacune des étapes qu’il nous propose.
Ainsi la différence, nous dit-il, est un concept identitaire. Pas moyen d’avancer une différence sans recours à l’identité. Différence fait couple avec l’identité par le fait que l’identité est le socle sur lequel se lève la distinction qui fait la différence. Par sa constitution, la différence s’extrait de l’identique à l’œuvre dans l’identité. La visée de la différence n’est pas celle de l’identité (24).
Autre argument : La différence produit du non identique. En plus de distinguer, la différence divise. Aristote use de la division de la chose pour atteindre enfin son essence.
La différence ne peut se produire que du fait de la position en surplomb de celui qui l’établit. Car il faut occuper une telle position pour diviser en deux la chose identifiée.
Enfin la différence est un concept de rangement. La différence permet le classement des choses et leur rangement selon un ordre. Il peut être hiérarchique ou utilitaire. De ce fait, la chose différenciée devient plus facilement accessible.
La différence est ainsi marquée par son caractère identitaire, distinctif et classificatoire. François Jullien se montre sur ce point subtil. Je lis ce passage :
Parler de la diversité des cultures en termes de différence désamorce ainsi ce que l’autre de l’autre culture peut avoir d’extérieur et d’inattendu, à la fois de surprenant et de déroutant, d’égarant et d’incongru. (28-29)
La différence évacue la caractéristique de l’autre quand il apparaît de façon inopinée. Elle introduit le concept de diversité tout fait pour désamorcer la dimension de surprise propre au surgissement de l’inopiné. Devant la platitude de la différence, Jullien se demande si ce ne serait pas un concept paresseux (29).
L’écart se différencie de la différence en tant qu’il ne répond pas un principe d’identité. L’écart ouvre. Quand il s’agit des cultures, il les sépare. De ce fait, les cultures apparaissent dans leur fécondité.
Jullien compare la différence avec l’écart. Autant la différence introduit la distinction, autant l’écart le fait avec la distance. L’écart «marque le lieu d’une séparation et d’un détachement.» (32) Comme concept de la distance, il implique le mouvement de la séparation. Si la différence se manifeste par son caractère analytique discriminant, l’écart est dynamique. L’écart se creuse. Loin d’être descriptif comme la différence, il est productif. En effet, du fait de la distance que l’écart creuse, il est source de tensions productives entre ce qu’il met à distance, ce qu’il sépare. Jullien dit que cette tension fait travailler les écarts. Les pensées occidentales et chinoises mises en tension se mettent en regard les unes des autres. Et cette mise en tension s’avère féconde. Elle met en évidence telle spécificité de l’une en regard de l’autre qui, autrement, n’aurait guère été visible. Les pensées ainsi mises en tension, donnent à penser. Elles le font dans l’espace de réflexivité, créé par l’écart.
Jullien accentue sa distinction entre différence et écart. La différence introduit le rangement consécutif à la distinction, lui donnant son caractère classificatoire. L’écart, lui, est une figure du dérangement. Et cette figure est source non pas d’identité mais de fécondité (35).
L’écart se produit : on fait un écart, on creuse un écart. Alors que la différence ne produit rien. L’écart est une opération qui va à l’opposé du rangement.
Faire un écart, c’est sortir de la norme, procéder de façon incongrue, opérer quelque déplacement vis-à-vis de l’attendu et du convenu (35).
Alors que la différence est le « maître-outil des nomenclatures et des typologies », l’écart est « un concept exploratoire. » Si la différence spécifie, l’écart est inventif. « C’est un concept aventureux. »
L’écart produit de l’entre (49). Par sa fonction distinctive, la différence permet le développement de l’analyse, mais elle ne produit rien. En mettant en tension les deux bords qu’il sépare, l’écart ouvre, « libère, produit de l’entre entre eux » (50)
Y pensons-nous à cet entre que l’écart ouvre ? La plupart du temps, non. L’entre passe la plupart du temps inaperçu. L’entre non seulement passe inaperçu, mais il est sans détermination. Il existe, non pas en plein, mais en creux (50) : « Le propre de l’entre, c’est de n’avoir rien en propre. »
Nous arrivons à un passage sur cet entre qui requiert plus particulièrement notre attention. Lisons ce passage de Jullien :
Car on voit pourquoi, de l’entre, la philosophie européenne n’a pu s’occuper : L’entre est ce qui, par nécessité – ou disons aussi bien, fatalité – échappe à la question de l’Être, celle à partir de laquelle s’est articulée depuis les Grecs, la philosophie (51).
L’entre, on l’a vu, échappe à la détermination. C’est dire qu’il fait défaut à ce qui fait qu’une chose est, à ce qui est en propre, à la propriété. Ainsi, l’entre échappe à ce qui a prise du discours sur l’être, à l’ontologie :
L’entre n’a pas d’ « en soi », ne peut pas exister par soi ; à proprement parler, l’entre n’est pas. Du moins est-il sans qualité (51).
Il apparaît que ce passage présente à nos yeux le plus grand intérêt. Si nous le rapportons à l’effet d’entre tel qu’Allouch le produit dans son livre, on voit se mettre en place la cohérence du propos. L’entre, selon Jullien, n’a ni en soi, ni par soi. Dire qu’il échappe à la question de l’Être peut très bien se formuler ainsi : dans le champ du rapport sexuel, là où le rapport est attendu, il n’existe pas. Il n’y a pas d’Être du rapport. Au sens où ici Jullien l’entend. Ou, pour le dire autrement, il n’y a pas de discours sur l’être du rapport puisque rien ne vient s’y inscrire qui puisse lui donner existence.
Retenons cette proposition de Jullien selon laquelle l’entre, par nécessité, est ce qui échappe à la question de l’Être. Jullien tire les conséquences de ce constat :
La pensée de l’Être, que développe l’ontologie, a dû, ne pouvant prendre pied dans l’ « entre », se reporter en savoir de l’« au-delà », compris aussi bien comme « au-dessus », meta, autrement dit en « méta-physique ». Elle n’avait d’autre issue que dans ce dépassement. Disons-le aussi simplement : ne pouvant donner consistance à l’ entre dénué d’essence, ne pouvant donc penser l’entre, on a pu – dû – penser l’au-delà et son aspiration vertigineuse : non plus metaxu, dit le grec, mais méta (53).
L’entre prend en défaut la pensée de l’Être, propre de l’ontologie. De fait, confrontée à ce défaut, cette pensée se reporte sur le méta de métaphysique. Autrement dit, c’est le défaut ontologique de l’entre qui ne laisse d’autre recours à la pensée de l’Être que de se déplacer vers un autre savoir, le savoir de l’au-delà. Cet au-delà ne fait que souligner l’absence d’essence de l’entre, soit l’impossibilité de le penser. En une phrase, faute de pouvoir penser l’entre, il a fallu penser un au-delà. Dès lors, la métaphysique est devenue le symptôme de l’entre, soit la manifestation de sa non-essence, par l’affirmation d’une essence au-delà. Étant donné la nécessité de l’entre, la métaphysique témoigne de cette nécessité par le contournement qu’elle en fait pour penser un au-delà.
Il s’ensuit que toute ontologie manque l’entre. Ainsi Platon, ne pouvant donner consistance à l’entre de l’entre de la vie, a dédoublé la vie et a promu dans l’au-delà ce qu’il appelle dans le Théétète la vraie vie (alethes bios) (57). La conséquence de cette décision a été que la philosophie s’est retrouvée à penser « la vraie vie » mais à ne plus penser le vivre. Le vivre est ce qui échappe par définition à la recherche d’une essence et qui se démarque de toute saisie possible dans l’Être.
Happés, fascinés par les Extrémités, qui seules se détachent, possèdent des caractéristiques qu’on peut distinguer et dont on peut faire des différences, qui se constituent par conséquent en essences et donnent lieu à définition, les Grecs ont dû négliger l’entre-deux du flux et l’indistinct de la transition échappant aux assignations (57).
Aussi, Jullien s’installe-t-il entre Chine et Occident. Il ne campe pas à l’une des extrémités de cet espace. Il se situe entre les deux, mieux il opère entre les deux.
Je me situerai donc plutôt dans ce « nulle part » de l’entre, c’est-à-dire dans cet « entre », qui n’a pas sa place, de l’ « a-topie ». Dans cet « entre » qui n’est jamais isolable, ne possède rien en propre, est sans essence et sans qualité […]
Socrate, par exemple, est entre. Entre les sophistes et les moralistes. Il est « nulle part », n’est d’aucun côté, d’aucun parti, impossible à localiser (62).
La tâche à laquelle s’assigne Jullien est de retrouver la pensée de l’entre après que celle-ci ait été enfouie sous les monceaux de la pensée de l’Être qui a recouvert le tout en ne laissant que des traces dispersées de son passage.
Que garder de cette pensée de l’entre que nous propose François Jullien ? Quel rapport avec le développement qu’en fait Allouch lorsqu’après s’en être emparé puis avoir nommé l’espace du vrai trou dans la mise à plat du nœud borroméen, il l’a nommé ri ? Y a-t-il rapport entre la triple inexistence qui caractérise ce lieu et le trou ontologique dont nous parle Jullien, trou produit par l’écart, sa mise en tension, et son rejet de la différence au profit de la promotion d’un concept aventureux ? Notre réponse est que oui dès lors que Jullien pose en terme d’exclusion l’entre et l’ontologie.
À propos du « nulle part », avancé par Jullien pour parler de l’espace « entre », il y a un terme de Lacan dans le séminaire d’un Autre à l’autre qui doit retenir ici notre attention : celui de nullibiété.
Dans la séance du 21 mai 1969, du séminaire, dans la transcription AFI, se lit ceci :
Le système de nulle part, voilà, pourrait-on dire, ce qu’il nous faut exposer. C’est bien là que prendrait son sens enfin le terme d’utopie, mais cette fois réalisée du bon bout, si je puis dire. La vieille nullibiété à laquelle, dans les temps anciens, j’avais redonné le lustre qu’elle mérite pour avoir été inventée par l’évêque Wilkins, ça n’est nulle part, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit de la jouissance. Ce que l’expérience analytique démontre, encore faut- il le dire, c’est que, par un lien à quelque chose qui n’est rien d’autre que ce qui permet l’émergence du savoir, la jouissance est exclue, le cercle se ferme. Cette exclusion ne s’énonce que du système lui-même en tant que c’est le symbolique. Or, c’est par là qu’elle s’affirme comme réel, réel dernier du fonctionnement du système même qui l’exclut nulle part, la voici redevenue partout de cette exclusion même qui est tout ce par quoi elle se réalise et c’est bien là, on le sait, à quoi s’attache notre pratique, démasquer, dévoiler ce qui, là où nous avons affaire, dans le symptôme, démasque cette relation à la jouissance, notre réel, mais pour autant qu’elle est exclue.
Dans la version Nassif du même séminaire, un autre mot vient à la place: « La vieille « nullibiquité ». Dans la version du Seuil, de 2006, se retrouve : « La vieille nullibiété (2006, p. 327)». Dans la version dite Gaogao, « La vieille nullibiquité » revient. Dans celle de Valas, on retourne à : « la vieille nullibiété ». Dans celle de l’école lacanienne de
psychanalyse, c’est : « la vieille nullibiquité ». Dans une nouvelle version dite ALI, se lit : « La vieille « nullibiquité »».
L’absence de bande audio sur cette séance ne permet pas de trancher sur le bon terme.
Une recherche dans le Trésor de la langue française1 et dans le Littré2 ne laisse aucune trace de ces deux termes. Il en va de même du Cambridge dictionary3 dans la recherche de nullibiety.
Dans les « 789 néologismes de Jacques Lacan »4 , on lit les deux occurrences suivantes :
1 http://www.cnrtl.fr/definition/
2 http://www.littre.org/
3 https://dictionary.cambridge.org/spellcheck/english-french/
Nullibiquité :
Nf : 14/07/72, L’étourdit, Autres Écrits, p. 451.
« le stéréotype que tout homme soit mortel, ne s’énonce pas de nulle part. La logique qui la date n’est que celle d’une philosophie qui feint cette nullibiquité. »
Nullibiété :
Nf. : 15/08/56, le séminaire sur « La lettre volée », Écrits, p. 23.
« Comment il se fait que la lettre n’ait été trouvée nulle part (…). Faut-il que la lettre, entre tous les objets, ait été douée de la propriété de nullibiété. »
Dans La lettre volée, Lacan écrit :
Faut-il que la lettre, entre tous les objets, ait été douée de la propriété de nullibiété : pour nous servir de ce terme que le vocabulaire bien connu sous le titre du Roget reprend de l’utopie sémiologique de l’évêque Wilkins ?
Il s’agit du Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases. On y trouve une occurrence : Nullibiety, 1875. Selon Pierric Brient6, il s’agit là d’un terme forgé par Wilkins. Lacan a repris ce terme dans le Roget’s, et l’a traduit par nullibiété7. Brient note incidemment que Roget est aussi un personnage des « Histoires extraordinaires » de Poe.
La note de bas de page du texte de La Lettre volée est la suivante :
Celle-là même (il s’agit de l’utopie sémiologique de Wilkins) à qui M. Juan Luis Borges (sic !), dans son œuvre si harmonique au phylum de notre propos, fait un sort que d’autres ramènent à ses justes proportions. Cf. Les Temps modernes, juin-juillet 1955, pp. 2135-36, et oct. 1955, pp. 574-75.
Dans l’article en question, « La langue analytique de John Wilkins »8 , José Luis Borges écrit : « Dans la langue universelle conçue par Wilkins au milieu du XVIIe siècle, chaque mot se définit lui même. Descartes, dans une lettre datée de novembre 1629, avait déjà noté qu’au moyen du système décimal de numérotation, nous pouvons apprendre en un seul jour à nommer toutes les quantités jusqu’à l’infini, et à les décrire dans une langue nouvelle, qui est celle des chiffres ; et il avait proposé la formation d’une langue analogue générale qui pût organiser et embrasser toutes les pensées humaines. John Wilkins, vers 1664, s’attaqua à cette entreprise. »
De ses propres réticences devant la classification de Wilkins, Borges écrit : « Mais il est notoire qu’il n’existe pas de classification de l’univers qui ne soit arbitraire et conjecturale. La raison en est fort simple : nous ne savons pas ce qu’est l’univers. »
Dans l’ouvrage de Wilkins, la nullibiété se situe dans la catégorie des mots se référant à l’espace (Words relating to space). Il se trouve dans la subdivision « l’espace où n’importe quelle chose est contenue » (space wherein anything is contained), et dans la subdivision
4 « 789 néologismes de Jacques Lacan », travail réalisé par un collectif de l’école lacanienne de psychanalyse, conçu et mis en page par Marcel Benabou, Laurent Cornaz, Dominique de Liège et Yann Pélissier, Paris, Epel, 2001. 789 néologismes de Jasa
5 Peter Mark Roget, Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases, classified and arranged so as to facilitate the expression of ideas and assist in litterary composition, Tome 6, Longman, Brown, Green and Longmans, London, 1856, p. 419.
6 Pierrick Brient, « Nullibiété », Essaim 2007/1(numéro 18) p. 129-132.
7 Idem, « On ne trouve aucune trace de ce terme en français, c’est manifestement Lacan qui en propose une traduction. »
8 José Luis Borges, « La langue analytique de John Wilkins », in Otras inquisitiones 1974, Buenos Aires. Traduction francaise : « Enquêtes » Folio-Essai, Gallimard, 1967, p. 140. Paru dans les Temps Modernes, n° 114, Paris, Gallimard, juin-juillet 1955.
« quand une chose est partout ; ou nulle part » (when a thing is in every place ; or none). Wilkins avance alors le terme d’ubiquity, omnipresence pour « partout » et de nullibiety pour « nulle part ».
L’originalité du terme nullibiété est qu’il s’agit d’un néologisme translittéré par Lacan à partir du néologisme en anglais nullibiety fabriqué par Wilkins. D’où l’effet de vertige produit par ce terme.
–
La prochaine fois, nous nous réunirons le 14 mars. Je vous propose de lire les chapitres II intitulé « Folie, première et seconde mort » et le chapitre III « Laisser tomber les enfants » qui valent vraiment la peine puisqu’ils nous proposent des façons de secouer le cocotier de nos habitudes à partir de la conséquence qu’Allouch tire de sa distinction entre les deux analytiques du sexe.
–